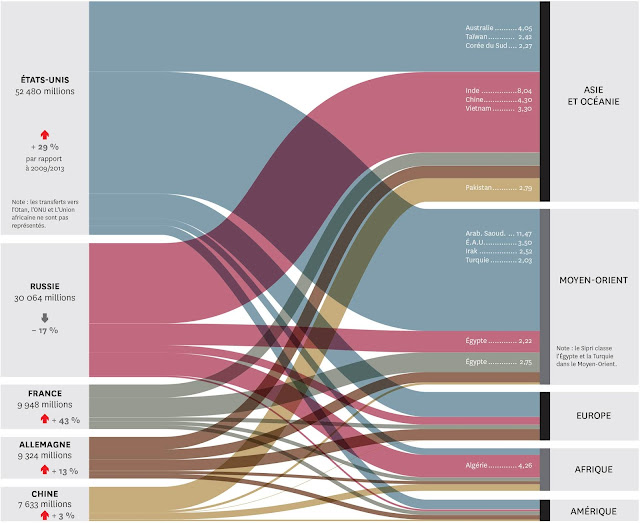Alors que l’offensive des forces rebelles du général Haftar piétine, Tripoli vient de conclure un accord militaire avec la Turquie. Un rapport destiné au Conseil de sécurité de l’ONU révèle les livraisons clandestines d’armes aux belligérants et la présence sur le terrain de combattants étrangers. Une escalade susceptible de déstabiliser un peu plus la région.
Après avoir largement contribué, depuis 2011, à armer les groupes djihadistes qui déstabilisent le Sahel, l’interminable guerre civile libyenne peut-elle maintenant menacer l’équilibre stratégique de la Méditerranée orientale ? Le risque d’une évolution aussi inquiétante est plus sérieux que jamais depuis la signature, le 27 novembre, entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du gouvernement d’union nationale libyen (GNA), reconnu par l’ONU, Faiez Sarraj, d’un accord qui provoque la colère de la Grèce et agite toute la région, de Chypre à l’Égypte, en passant par Israël.
Car cet accord sur la délimitation maritime, qui donne à Ankara l’accès à de vastes zones riches en hydrocarbures revendiquées par ses voisins, comporte aussi un volet de coopération sécuritaire qui autorise l’envoi en Libye d’une éventuelle aide militaire turque. Or le GNA, basé à Tripoli, est actuellement confronté à une offensive de l’autre pôle de pouvoir libyen, l’Armée nationale libyenne (ANL), du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, maître de la Cyrénaïque, à l’est du pays. Et Haftar
est politiquement et militairement soutenu par l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, tous rivaux régionaux d’Ankara.
En fait, à travers l’affrontement entre leurs partenaires libyens, c’est à une véritable guerre de basse intensité par procuration que se livrent d’une part la Turquie et le Qatar, alliés du GNA, et d’autre part l’Égypte, les Émirats et la Jordanie, alliés du « maréchal » de Benghazi. Une guerre qu’ils entretiennent, depuis des années, par leurs livraisons d’armes, leurs envois de « conseillers », leur aide financière, leur appui diplomatique et parfois l’intervention directe de leur aviation. Le tout en violation, jusqu’à ce jour impunie, de l’embargo sur les livraisons d’armes décidé par les Nations unies en février 2011.
C’est ce que dévoile un rapport remis le 9 décembre au Conseil de sécurité (y accéder ici) par un groupe d’experts chargés d’observer le développement du conflit sur le terrain, en particulier depuis le lancement de l’offensive de Haftar contre Tripoli, le 4 avril 2019. Composé de deux spécialistes des armes, deux spécialistes des groupes armés, un expert en transports, notamment maritimes, et un expert dans le domaine financier, ce groupe a livré un document de 376 pages, dont Mediapart a obtenu une copie, qui contient une analyse détaillée du conflit en cours et une enquête tout aussi précise sur les très nombreuses violations de l’embargo sur les armes et sur les responsables – États, entreprises, personnes – de ces violations.
Enseignement majeur de ce rapport : les deux pôles de pouvoir en Libye – le gouvernement de Tripoli, adoubé par la communauté internationale, comme les forces de Haftar, à Benghazi, en rébellion ouverte contre le premier – ont reçu, au moins jusqu’à l’été dernier, des livraisons clandestines d’armes, de munitions et de matériels militaires, et ont, aujourd’hui encore, recours au renfort de mercenaires étrangers, en violation de l’embargo de l’ONU. Le constat avait déjà été dressé, au fil des ans, par les médias, mais il est ici confirmé et documenté par les experts de l’ONU, qui s’appuient sur des témoignages directs et sur de nombreux documents comptables et photographiques.
Toutefois, le rapport ne mentionne pas l’aide apportée par certains États, l’Égypte, la Russie ou la France, à Haftar. Sous la forme d’envois d’éléments des Forces spéciales ou de la DGSE, Paris a activement contribué au renseignement tactique et à la formation des combattants de l’ANL. Cette aide, a priori contradictoire avec la reconnaissance officielle du GNA par Paris, s’explique, selon la DGSE et le Quai d’Orsay, par la nécessité de s’appuyer en Libye sur la force militaire la plus crédible pour lutter contre le djihadisme. C’est-à- dire l’armée du pouvoir de Benghazi.
Deuxième enseignement du rapport : l’attitude du pouvoir de Tripoli et de celui de Benghazi face à l’embargo des Nations unies jette plus qu’un doute sur la sincérité de leur engagement en faveur de la paix, en réponse aux démarches engagées depuis des années pour rechercher une solution politique négociée au conflit par l’envoyé spécial de l’ONU, l’universitaire libanais Ghassan Salamé.
Troisième enseignement d’importance : même si, selon le rapport, les « capacités militaires des deux camps ont été en apparence renforcées par l’apport de combattants étrangers, l’impact de ces renforts sur le déroulement du conflit a été limité. Les opérations ont été dominées par le recours à des munitions guidées de précision tirées par des avions sans pilotes, ce qui a, dans une certaine mesure, limité les dommages collatéraux que l’on peut redouter dans un tel conflit ». Dans ces conditions, relèvent également les experts de l’ONU, « les pertes parmi les combattants et les civils demeurent faibles. Le conflit continue de poser des menaces locales aux civils libyens, forcés à fuir par les combats ou victimes de l’utilisation comme armes ou de l’exploitation financière des institutions vitales de l’État, comme la distribution de l’eau, de l’électricité ou des carburants ».
Le rapport ne cite aucun bilan des pertes humaines depuis le début de l’offensive de Haftar contre l’ouest du pays mais d’autres sources de l’ONU évaluent à un millier de morts et plus de 140 000 déplacés le nombre des victimes, civiles et militaires, recensées depuis huit mois. On est loin, en effet, des massacres syriens ou yéménites.
Quatrième constat important des experts : les opérations militaires des forces du GNA et de l’armée de Haftar, ainsi que les frappes des forces du commandement américain antiterroriste en Afrique (AFRICOM), continuent à affaiblir les structures organisationnelles des groupes d’Al-Qaïda ou de ce qui reste de Daech, et réduisent au moins temporairement leurs capacités opérationnelles en Libye. Mais, selon le rapport, des cellules dormantes de Daech existent toujours à Tripoli, Misrata, et des groupes autonomes sont signalés à Sebha, Murzuk et Al Qatrum, au sud du pays, alors que le quartier général local de l’organisation semble toujours être dans la région de Bani Walid, à 150 km au sud-est de Tripoli.
Les experts relèvent que le 6 juillet 2019, la branche médias de Daech a diffusé une vidéo du chef de l’organisation en Libye, Mahmoud Massoud al-Barassi, également connu comme Abou Moussab Allibi, dans laquelle il affirmait que la Libye était devenue l’un des principaux axes des futures opérations, destinées à compenser la perte des territoires et de l’influence en Syrie. Selon le document, « Daech finance actuellement ses activités dans le pays par le vol, les enlèvements contre rançon, l’extorsion, la contrebande. La taxation des réseaux de trafic d’êtres humains demeure l’une des ressources majeures de l’organisation en Libye ».
Comment le « Aisling » est devenu le « Karama »
« L’offensive militaire sur Tripoli par l’ANL de Khalifa Haftar et le conflit qui a suivi ont paralysé le processus politique national, interrompu les réformes, et contribué à l’instabilité générale dans l’ensemble du pays, constatent les auteurs du rapport. Des groupes armés disparates, certains jusque-là en conflit les uns avec les autres, se sont unis pour s’allier soit avec le GNA, soit avec Haftar. Cette nouvelle phase d’instabilité, combinée avec les intérêts de certains acteurs, étatiques ou non, a amplifié le conflit par procuration qui a pris forme après 2011. [...] Toutes les parties en conflit ont reçu des armes et des équipements militaires, un soutien technique, et l’aide de combattants non libyens en violation de l’embargo sur les armes. La Jordanie, la Turquie et les Émirats arabes unis ont régulièrement, et parfois de manière flagrante, fourni des armes en faisant peu d’efforts pour dissimuler la source des livraisons. »
C’est le moins que l’on puisse dire à la lecture du rapport et de ses quelque 300 pages d’annexes documentaires. Si, selon le New York Times, la Russie, après quatre ans de soutien financier et diplomatique discret à Haftar, a déployé à bas bruit, l’automne dernier, 200 mercenaires, dont plusieurs équipes de tireurs d’élite appartenant au « Groupe Wagner », une entreprise de mercenariat privée proche du Kremlin, c’est une forme d’aide beaucoup plus ouverte, voire revendiquée qu’apportent Amman et Abou Dabi à Haftar, et Ankara au GNA.
Même si leurs livraisons utilisent des bateaux ou des avions gros porteurs enregistrés en Moldavie, au Kazakhstan ou en Ukraine, et suivent parfois des parcours zigzagants avant d’atteindre la Libye, ce sont des armes ou des équipements militaires qu’ils produisent ou qu’ils utilisent dans leurs propres armées qu’ils fournissent la plupart du temps. Ce qui simplifie grandement, selon les experts de l’ONU, l’identification des responsabilités.
Il en va ainsi des dizaines de drones de combat Bayraktar, produits en Turquie, livrés en pièces détachées à Tripoli par trois navettes d’avions cargos entre mai et août 2019. Les puissants drones Wing Loong, équipés de missiles air-sol Blue Arrow fournis par les Émirats à Haftar, ne sont pas fabriqués dans le Golfe, mais tous les répertoires d’équipements militaires indiquent qu’Abou Dabi en a constitué un stock considérable dans lequel on puise pour soutenir l’allié libyen. Compte tenu de leurs caractéristiques de vol et de leurs aptitudes militaires – ils peuvent emporter plus de huit fois la charge en munition d’un Bayraktar –, ils constituent un atout considérable entre les mains de Haftar, même si, selon le rapport, ses forces en ont déjà perdu deux sur huit.
Pour les blindés à roues, de tous les types, du véhicule de patrouille légèrement protégé au transport de troupes blindé, dont les combattants libyens sont très demandeurs pour remplacer leurs rustiques 4X4 Toyota équipés de mitrailleuses, de canons sans recul ou de lance-missiles antichars, l’identification des sources est encore plus simple : les 14 types de blindés légers qui équipent aujourd’hui les deux pôles de pouvoir sont produits soit en Turquie, comme la cinquantaine de Kirpi débarqués en mai 2019 à Tripoli, soit en Jordanie ou aux Émirats, comme la quasi-totalité de ceux fournis à Haftar.
La transaction la plus complexe et financièrement la plus déroutante découverte par les experts concerne le transfert d’un patrouilleur maritime irlandais, le Aisling, sorti des chantiers de Cork en 1979, retiré du service en 2016 et intégré à la force navale de Haftar sous le nom de Karama (« Dignité ») en mai 2018. Entre-temps, le navire a été vendu pour 150 000 euros à une firme néerlando- seychelloise et immatriculé à Belize, cédé pour le triple de ce prix à une firme émiratie, immatriculé au Panama comme « yacht de plaisance », puis revendu à une firme de Benghazi pour 1,5 million de dollars. Après quoi, il a été réarmé des deux canons de 20 mm et du canon de 40 mm qui l’équipaient sous pavillon irlandais, comme le prouve une photo prise à Ras Lanouf en avril 2019, qui figure dans le rapport. Mais les investigations des experts n’ont pas permis de découvrir les raisons de l’augmentation extravagante du prix du navire. Ni d’en identifier les bénéficiaires.
On le sait aujourd’hui, la vaste offensive contre Tripoli d’avril dernier pour laquelle Haftar avait demandé et obtenu la majeure partie des armements recensés dans le rapport et qui avait, en réponse, provoqué une intensification des livraisons turques au GNA, s’est enlisée dans les sables. Les forces de Benghazi ont bien enclenché, comme prévu, l’encerclement de la ville par le sud et l’ouest et investi quelques positions indispensables au lancement d’un assaut, mais elles ont dû renoncer à aller au-delà.
Selon les experts de l’ONU, la tentative d’arracher Tripoli au déploiement de groupes armés locaux qui protégeaient la ville a échoué car les accords conclus par Haftar avec certains de ces groupes n’ont pas tenu. Nombre de ces groupes ont au contraire fait cause commune avec les puissantes milices de Misrata, alliées au GNA. Le conflit s’est immobilisé sur la ligne de front du moment, à une centaine de kilomètres au sud-est de Tripoli, et lorsque les forces du GNA ont contre- attaqué et repris fin juin la ville stratégique de Gharyan, la crédibilité stratégique de Haftar a été durablement affectée.
Pourtant, en vue de cette offensive, le maître de la Cyrénaïque avait singulièrement renforcé sa « légion étrangère », ainsi que le montre le rapport. Face au GNA qui avait obtenu le renfort de 100 Soudanais et de plus de 700 Tchadiens, appartenant à des groupes armés hostiles aux régimes de Khartoum et N’Djamena, il avait mobilisé 700 Tchadiens et plus de 2 000 Soudanais. La moitié du contingent soudanais appartenait à la redoutable Force de soutien rapide (RSF), unité de répression détestée sous l’ancien régime et aujourd’hui ralliée comme son chef, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, au nouveau pouvoir dont il est devenu l’homme fort.
Selon les investigateurs de l’ONU, le recrutement de ces 1 000 combattants soudanais a eu lieu en application d’un contrat conclu entre Hemeti et Ari Ben- Menashe, le président israélo-canadien de la société de lobbying Dickens & Madson, basée à Montréal. Aux termes de ce contrat, dont le texte intégral figure dans les annexes du rapport, Dickens & Madson s’engage en effet à « s’efforcer d’obtenir du commandement militaire dans l’est de la Libye [c’est-à-dire de Haftar – ndlr] des fonds pour le Conseil de transition soudanais en échange d’une aide militaire » aux forces de l’ANL.
Malgré ces renforts en combattants et les livraisons continues d’armements et de munitions modernes, en violation toujours impunie de l’embargo de l’ONU, aucun des deux pôles de pouvoir, le rapport le confirme, n’a aujourd’hui « la capacité militaire de prendre l’avantage ». La situation se résume donc, pour l’heure, à un face-à-face entre les forces des deux camps le long de la ligne de front, sur fond d’alliances ou de rivalités changeantes parmi les 30 milices ou groupes armés recensés par les experts dans l’orbite du GNA et les 46 milices ou groupes armés qui gravitent autour de Haftar.
Comment briser ce statu quo stratégique ? En demandant aux alliés et protecteurs étrangers une intervention militaire directe ? Haftar l’a déjà fait. En 2017, comme l’a révélé Mediapart, des Rafale vendus par la France à l’Égypte ont bombardé les localités libyennes de Derna et Houn, en soutien aux forces de l’ANL. Et en juillet dernier, le rapport le révèle, des Mirage 2000 livrés par Paris aux Émirats arabes unis ont bombardé un camp militaire du GNA, à Tadjoura, après avoir décollé d’Al Khadim et Jufra, deux bases en territoire tenu par les forces de Benghazi.
Après la signature de l’accord de coopération sécuritaire entre Tripoli et Ankara, une telle initiative pourrait fournir à Erdogan le prétexte pour intervenir directement en Libye, comme il en a récemment brandi la menace. Alors que Haftar continue d’annoncer le lancement prochain de la « bataille décisive », il est manifestement temps pour les alliés des deux camps de mesurer les périls qu’une escalade de la guerre en Libye ferait courir à toute la région. Paris, Berlin et Rome viennent de lancer un appel à « toutes les parties libyennes et internationales à cesser toute action militaire [...] et à reprendre un processus de négociation crédible mené par les Nations unies ». Reste à savoir si la livraison continue et impunie aux belligérants d’armes et de munitions est le meilleur moyen de les inciter à négocier...