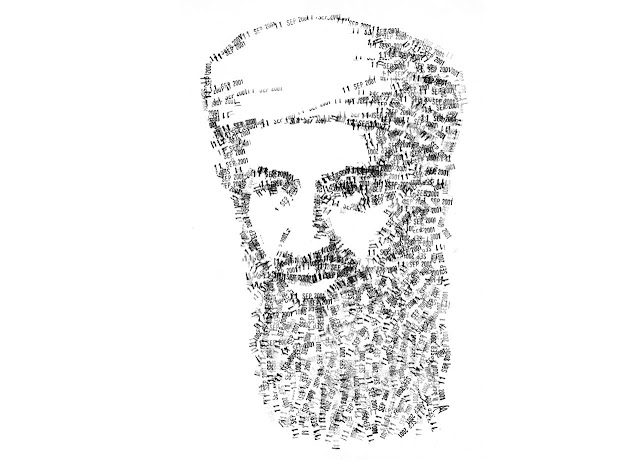L’incarcération du chef de clan mafieux Ange-Toussaint Federici n’a pas nui aux affaires de sa famille. Un rapport de police dévoile comment celui-ci continue de tirer les ficelles depuis sa prison, par l’entremise de ses visiteurs.
Derrière les murs gris de la prison ultra sécurisée d’Alençon - Condé-sur-Sarthe (Orne), l’une des principales figures du crime organisé français, Ange-Toussaint Federici, 57 ans, jardine. Entre deux parloirs, c’est à lui, et à quelques autres, qu’il revient d’entretenir les cours végétalisées du centre pénitentiaire. Détenu particulièrement signalé (DPS), ce fils de berger, originaire du village de Venzolasca (Haute-Corse), a même obtenu d’être le coordinateur de cette activité proposée par l’établissement. Une manière de passer le temps pour cet homme condamné à trente ans de réclusion criminelle pour l’assassinat, à Marseille, en 2006, de trois voyous qui contestaient sa mainmise sur la région de l’étang de Berre. Une façon, aussi, d’entretenir l’image d’un détenu paisible. La réalité est tout autre : Ange-Toussaint Federici continue, de fait, de diriger à distance un clan mafieu très hiérarchisé, disposant d’un vaste réseau familial et amical.
Longtemps, il a pensé pouvoir gérer ses affaires à l’abri des regards, depuis la prison. Il se trompait. Les parloirs et les unités de vie familiale où ses proches lui rendent visite étaient truffés de micros. Même les téléphones de ses affidés, en Corse ou sur le continent, étaient sur écoute, parfois aussi leurs domiciles et leurs véhicules. Cette enquête inédite, menée de septembre 2015 à juillet 2017 par la police judiciaire (PJ), a mis en évidence l’emprise de cette famille sur l’île, ainsi que son « business » sur le continent et à l’étranger.
Un long rapport d’étape, daté du 21 juillet, dont Le Monde a pris connaissance, fournit de nombreuses précisions sur les méthodes du « jardinier » de la prison d’Alençon - Condé-sur-Sarthe et, à un degré moindre, de son frère Jean-François, condamné quant à lui à trente ans de réclusion pour un double assassinat et détenu à Toulon. « Malgré leur incarcération, les frères Federici continuaient à piloter diverses activités criminelles, dont une partie était totalement liée à la crainte qu’ils inspiraient ou s’estimaient légitimement en droit d’inspirer », est-il écrit dans ce texte tout en nuances.
Ces investigations offrent une plongée rare au cœur d’un système mafieux auquel des élus et des entrepreneurs insulaires en vue sont confrontés. Les faits révélés ne relèvent pas nécessairement d’infractions pénales et portent souvent sur des activités a priori légales. De même, il faut conserver une certaine prudence par rapport aux propos interceptés qui peuvent refléter une réalité déformée ou inventée par leurs auteurs. Mais il apparaît clairement que les Federici, surnommés les « bergers » en référence à l’activité de leur père et à leur faible goût pour la subtilité, usent de tous les moyens pour s’infiltrer dans la vie économique et politique de leur île.
Parmi ceux qui venaient régulièrement rendre visite en prison à Ange-Toussaint Federici, alias « ATF », son fils Pierre, dit « Petit Pierre », était le plus assidu. Il est présenté par les enquêteurs comme «l’héritier». Pierre- Louis Montet, alias « Pilou », est, lui, qualifié par ces mêmes enquêteurs d’« homme de confiance » et d’« affairiste des Federici ». Autre visiteur régulier : Paul Bastiani, un cousin, toujours prêt à rapporter fidèlement à « ATF » les agissements des membres du clan et l’évolution des affaires sur l’île. Lors de ces rencontres, le « jardinier » leur parle de la levée de son statut de DPS ou de son souhait d’être transféré à la prison de Borgo (Haute- Corse). Surtout, il donne des ordres.
En juin 2016, le chef de clan est inquiet. Avec l’ami « Pilou », ils évoquent les parts que détient Jean Quilichini, un entrepreneur proche de la famille, dans l’Hôtel Casadelmar, un établissement prestigieux de Porto- Vecchio, et qu’il pourrait céder. Pour tenter de récupérer la participation de M. Quilichini, « ATF » explique à « Pilou », lors d’une nouvelle visite au parloir, comment il doit s’y prendre. Et il ajoute : « Si on veut, il nous revient 2 millions [d’euros]. »
UNE CONNAISSANCE AIGUË DES AFFAIRES
Dans les semaines suivantes, le PDG du Casadelmar, Jean-Noël Marcellesi, reçoit plusieurs visites d’hommes qu’il dira ne pas connaître. « Pilou » Montet est l’un d’eux. Le 25 juin 2016, ce dernier affirme représenter les intérêts de M. Quilichini et veut s’entretenir de la cession de ses parts. Il est venu avec ce même Jean Quilichini et un homme de main du clan, David Costa-Dolesi, qui restent dans la voiture à l’extérieur. Le PDG ne donne pas suite à ces propositions. Dans l’après- midi, Costa-Dolesi se présente à l’hôtel et demande à voir M. Marcellesi. En vain, ce dernier est absent. « L’intervention de David Costa-Dolesi auprès de M. Marcellesi démontrait parfaitement le rôle qu’il tenait dans le système de pression et d’extorsion exercé par le clan Federici sur certains entrepreneurs et acteurs du monde économique insulaire », assure le rapport d’enquête.
Les gendarmes ayant été alertés, un magistrat marseillais délivre, en février, un réquisitoire supplétif pour des faits de tentative d’extorsion en bande organisée. «Je ne suis pas quelqu’un qui menace les gens», assure aujourd’hui au Monde M. Montet. D’après lui, il s’intéressait à la reprise de l’entreprise de M. Quilichini et n’agissait, ce jour-là, qu’en son nom. Quid des échanges avec Ange- Toussaint Federici lors de ses visites à la prison ? « Ce sont des discussions à bâtons rompus, sans importance, affirme-t-il. Mes relations avec “Toussaint” sont purement amicales. On me fait porter un chapeau bien trop grand, jamais je ne déborde la ligne.» Entendu à la mi-novembre par les enquêteurs, M. Montet a bénéficié du statut de témoin assisté sur les faits d’extorsion et d’association de malfaiteurs dont il était soupçonné.
Au parloir avec son père, le 7 novembre 2015, « Petit Pierre » Federici fait, cette fois-ci, état de ses discussions avec Patrick Brandizi, l’un des principaux acteurs économiques de Haute-Corse, un homme dont le groupe de BTP a prospéré ces dernières années. « Petit Pierre » évoque notamment le projet de construction d’une zone commerciale à Pietranera, à la sortie nord de Bastia. Selon ses dires, l’entrepreneur refuse de se charger de l’attribution de l’ensemble des enseignes qui doivent s’installer sur le site et veut partager cette tâche. Pierre Federici assure avoir répondu qu’il entendait donc prendre une part de cette distribution. Une décision contestée par son père, qui lui fait la leçon sur les techniques d’intimidation et de prédation. « Il ne faut pas dire comme ça. (...) [Il faut dire]: “Le terrain, c’est le nôtre. Pour les enseignes, celui qui va rentrer, il faut qu’il passe par moi.” »
Un mois plus tard, « Petit Pierre » est de retour au centre pénitentiaire, cette fois dans l’unité de vie familiale. Il transmet alors à son père le « bonjour de Brandizi » et l’informe que ce dernier souhaite reprendre une station- service, ainsi que la gestion d’une brasserie. « ATF », loin d’être satisfait, lui ordonne de s’imposer de force dans ces deux affaires. Enfin, le 29 janvier2016, de nouveau au parloir, les Federici parlent d’un autre projet de construction commerciale sur un terrain de 50 hectares sur la commune de Vescovato. Face au refus de Brandizi de s’associer, au motif qu’il détient déjà des promesses de vente sur deux terrains contigus, « ATF » lui transmet un message par l’entremise de son fils: « Ici, tu n’achètes rien, nous y sommes, basta. »
Interrogé par Le Monde, Patrick Brandizi affirme qu’il n’aurait pas été « raisonnable et justifié » d’adresser une fin de non-recevoir brutale aux Federici, mais qu’il n’a jamais eu l’intention de faire affaire avec eux. «A Pietranera, ils voulaient me vendre un projet de construction de logements, je leur ai dit que j’avais déjà un projet en cours, depuis ils l’ont revendu. Pour Vescovato, ils voulaient faire venir un Decathlon sur leur terrain et m’associer à leur zone commerciale, j’ai dit non. A la limite, il pouvait y avoir une synergie pour aménager la circulation autour de mes terrains et du leur. »
Cet «activisme» prouve que les «bergers» ont une connaissance aiguë du monde des affaires et un goût prononcé pour la finance. Ainsi, il apparaît qu’un membre de la garde rapprochée d’« ATF » a fait appel à un cadre de la banque d’affaires Rothschild pour ouvrir une crêperie-glacier par le biais d’une société montée en Pologne. Dans sa maison, sonorisée par la police, le lieutenant d’« ATF » donne le fin mot sur le rôle du cadre bancaire en question, en mentionnant qu’il s’agissait en réalité d’élaborer un circuit de blanchiment d’argent. Sollicitée par Le Monde, la banque précise que l’intéressé a quitté ses fonctions. Ce dernier, dont le nom figure, encore aujourd’hui, au registre du commerce de Bastia, à la tête de plusieurs sociétés rattachables au clan Federici, n’a pas pu être joint par téléphone avant la publication de cet article.
D’autres interceptions techniques, effectuées sur le lieu de détention d’« ATF », entre le 7 novembre 2015 et le 19 juillet 2016, lèvent aussi le voile sur le souhait des Federici d’engager un partenariat avec Patrick Rocca, président du Groupe Rocca, l’un des premiers employeurs de l’île, présent dans de nombreux secteurs (transport, déchets, BTP, promotion immobilière et commerciale...). Les Federici sollicitent d’abord son aide pour trouver de nouveaux marchés pour leur société de fret aérien, Casinc’Air, active dans les différents aéroports de Corse et dont le chiffre d’affaires a baissé avec la perte de clients importants, comme Chronopost.
Les Federici, par le biais de « Petit Pierre », ont également démarché Patrick Rocca, détenteur de la franchise Decathlon sur l’île, pour le presser d’installer un magasin à cette enseigne sur un de leurs terrains, situé au sud de Bastia. Sollicité par Le Monde, M. Rocca se souvient de ces discussions: «Pierre Federici est venu me demander si j’avais du fret aérien, ce qui n’est pas le cas, ou si je pouvais l’aider à rencontrer un commercial de la société UPS, mais elle ne travaille pas en Corse – le marché est trop étroit. Pour le projet de Decathlon sur le terrain des Federici, cela en est resté au niveau des palabres, mais si un jour je veux me développer vers la Haute- Corse, pourquoi pas... »
L’ENTREPRENEUR FACE À L’HOMME DE MAIN
Dans leur rapport, les policiers sont bien plus suspicieux à l’égard de « Petit Pierre » et de ses démarches. Ils estiment «pouvoir légitimement [s’]interroger sur le caractère consenti des relations existantes entre M. Rocca et la famille Federici ». Il est vrai que les écoutes sont pour le moins troublantes. En mars 2015, « ATF » reçoit au parloir son frère aîné, Balthazar, maire du village familial de Venzolasca et élu (Parti radical de gauche) territorial de 2008 à 2015. Il évoque alors avec lui la reprise, par M. Rocca, de la compagnie maritime Société nationale Corse- Méditerranée (SNCM, devenue Corsica Linea). Le détenu modèle lâche qu’à sa sortie de prison il le fera « monter au village ». Une formulation qui, en langage d’initié, n’a rien d’amical. Pour M. Rocca, ces propos menaçants ne doivent pas être pris à la lettre.
«Faire monter au village ou descendre à la cave, ce sont des mots, nous explique-t-il. Ce qui compte, c’est le fruit de son travail. »
Les craintes de la police paraissent pourtant justifiées, si l’on en juge par la visite, le 26 décembre 2016, de David Costa-Dolesi – l’homme de main du clan aperçu dans le dossier Marcellesi – au bureau de ce même Patrick Rocca. «Cela a duré 45 secondes, relate ce dernier au Monde. Il m’a parlé d’un devis imaginaire, je lui ai demandé de partir, il a refusé, un incident a éclaté, mais il semble que cela soit une initiative individuelle. » L’agression physique a tourné à l’avantage de l’entrepreneur, mais David Costa-Dolesi a été arrêté et condamné, en février 2017, à dix- huit mois de prison.
D’après la PJ, les chefs d’entreprise ne sont pas les seuls à subir les pressions des Federici. Certains élus en font également les frais. Jean-Christophe Angelini, leader autonomiste et influent président de l’Agence de développement économique pour la Corse, en troisième position sur la liste conduite par Gilles Simeoni aux élections territoriales du 3 décembre, pourrait être l’un d’eux. Une hypothèse qui repose sur les dires de «Petit Pierre», qui ne cesse de répéter à son père qu’il est en relation avec l’élu au sujet de Casinc’Air, toujours en quête de nouveaux marchés. Les policiers, eux, précisent n’avoir aucune trace de liens directs entre «Petit Pierre » et M. Angelini. Un échange téléphonique, intercepté le 4 août 2015 et portant sur un marché de fret ouvert lors de l’extension de l’aéroport de Figari, est tout de même venu, selon eux, « confirmer le relationnel des Federici avec la famille Angelini ».
Ce jour-là, Pascal Angelini, le frère de Jean- Christophe, propose à « Petit Pierre » de rester en lice pour le nouveau marché de fret, afin de faire barrage à d’autres concurrents, puis de se désister en sa faveur. «Preuve, s’il en était, notent les policiers, que les règles d’attribution des marchés publics s’effaçaient devant la puissance de la famille.» Contacté par Le Monde, Jean-Christophe Angelini admet connaître Pierre Federici, mais précise qu’il n’a pas été «sollicité sur des affaires de marchés» et qu’il n’a jamais «abordé ces sujets avec lui ». Il dément, par ailleurs, le rôle prêté à son frère Pascal dans l’affaire de fret à Figari. S’agissait-il, pour le fils d’« ATF », de se prévaloir auprès de son père de contacts qu’il n’avait pas ou qu’il espérait avoir? La question demeure sans réponse. C’est aussi la limite d’une enquête essentiellement fondée sur la surveillance technique.
Le suivi des multiples conversations du clan montre que de nombreux projets ont avorté ou n’ont pas dépassé le stade de la parole. Ceux qui ont abouti visaient souvent des interlocuteurs disposant de peu de moyens de résistance. Ainsi, en octobre 2015, les échanges de « Petit Pierre » avec un oncle par alliance ont mis en évidence les mésaventures du maire de Saint-Florent (Haute- Corse). A l’époque, le fils d’Ange-Toussaint cherche à acquérir des terrains sur cette commune pour un projet de construction. Il s’intéresse de près au plan local d’urbanisme (PLU) et entame des discussions avec le maire (divers droite), Claudy Olmeta. Le 25 janvier 2016, il fait savoir à son père que l’élu « bloque tout ». « ATF » lui rétorque : « La prochaine fois que tu vas le voir, passe-lui le téléphone, juste pour lui dire bonjour.» Les policiers ont ce commentaire : « Un bonjour loin d’être purement amical... »
Le maire tient pourtant bon. Le 22 juin 2016, le PLU de Saint-Florent est adopté et rend caduque le projet des Federici. Trois jours plus tard, « Petit Pierre » se rend à la mairie pour « avoir des explications » et pour qu’on lui « arrange le terrain ». A l’issue du rendez- vous, il estime avoir « parlé dans le vide ». L’enquête ne dit pas ce qui s’est passé jusqu’au 26 septembre 2016 mais, à cette date, ce même Pierre Federici et son oncle annoncent avoir signé une promesse de vente et relancé ainsi le projet de construction. Le 15 janvier 2017, le terrain est acheté. Interrogé par Le Monde, le maire de Saint-Florent n’a pas souhaité s’exprimer.
La commune très touristique de Bonifacio (Corse du Sud) fait, elle aussi, partie des cibles du clan. En 2015, « Petit Pierre » informe son père de son intérêt pour une propriété de 20 000 mètres carrés, dont seuls 6 000 seraient constructibles. Ange-Toussaint a une solution toute trouvée: il faut aller voir le maire pour lui dire de doubler la surface constructible et de ne pas faire apparaître son nom sur les premières démarches. Une autre affaire a paru intéresser au plus haut point les Federici dans cette commune: un projet immobilier en jachère, situé au-dessus de la splendide baie de Santa-Manza, au nord de la ville. Des investisseurs suisses sont sollicités. La police note : « Cette société suisse récemment créée (mai 2016), dont l’objet social consiste à mettre en relation des investisseurs, pourrait constituer aisément un paravent destiné à donner une apparence légale à des opérations financières douteuses mises en place par le clan Federici. » Joint par Le Monde, le maire (LRM) de Bonifacio, Jean- Charles Orsucci, n’a pas souhaité faire de commentaires sur ces différents dossiers.
« J’AI LA RANCUNE TENACE »
Les surveillances effectuées sur les Federici attestent, enfin, la permanence de liens entre l’univers des voyous et celui de la politique. Elles laissent supposer que la fonction d’« agent électoral », selon l’expression policière, n’a pas disparu... L’interception, le 12 novembre 2015, de la ligne de « Pilou » Montet montre Dominique Viola, alias « Mimi », bras droit de Paul Giacobbi, alors président (divers gauche) de l’exécutif de la collectivité territoriale de Corse et député de Haute-Corse, en train de solliciter l’aide de Montet pour remplir les salles de meeting en vue des élections territoriales de décembre 2015. Viola lui demande de joindre ses contacts politiques, notamment à la mairie de Bastia, pour mobiliser du monde.
Le 29 novembre 2015, Viola le rappelle :
«Bombarde dans ton relationnel, parce que le meeting d’hier soir, il a déjà fait effet. (...) Regarde pour le 3 à Bastia et à Ajaccio pour le 4 au soir pour faire venir des gens. (...) Le vendredi sera terminal à Ajaccio, tu monteras ton copain V., comme ça vous venez. (...) Allez remplis, remplis.» Des efforts vains. M. Giacobbi sera battu par une coalition réunissant autonomistes et indépendantistes. Interrogé à ce sujet par Le Monde, M. Montet dira ne plus se souvenir. M. Viola, contacté à sa mairie de Santo- Pietro-di- Venaco, n’a pas souhaité répondre.
De sa prison, le paisible «jardinier» Federici peut ainsi suivre l’évolution des intérêts de son clan à coups d’ordres ou de conseils donnés à ses visiteurs chargés de les répercuter à l’extérieur. A l’occasion, il veille aussi à les protéger d’appétits concurrents. Au parloir, les 18 et 19 mars2017, il est ainsi en colère. Son cousin Paul vient de lui rapporter que les frères Moretti, autres figures du banditisme insulaire, ont tenté de mettre la main sur des affaires de promenades en mer dans l’extrême Sud, un secteur très touristique qu’il considère être sous son contrôle. «Les Moretti, les Moretti? Celui qui a une discussion avec ces gens-là, une discussion hein, c’est fini, terminé, il n’y a plus rien ! (...) Ces réunions, ça, c’est de la merde, tu sais ce que j’ai fait quand je suis arrivé, j’ai pris mon sac, je suis descendu et bouh bouh bouh [il imite trois coups de feu], il faut faire comme ça. (...) Je vais les éradiquer, j’ai la rancune tenace, je te dis... Même les enfants... La rancune, je la garde. »
A eux seuls, ces propos illustrent sans doute la crainte inspirée en Corse par le seul nom des Federici. Mais si la violence est une arme, elle ne suffit pas, notamment face aux services de l’Etat. D’autres groupes mafieux insulaires, plus sophistiqués, comme La Brise de mer, en Haute-Corse, ou celui dirigé par Jean- Jérôme Colonna en Corse du Sud, ont traversé, à partir des années 1980, près de trente ans d’histoire criminelle sans avoir jamais été observés d’aussi près. Pour l’avocat historique de la famille Federici, Me Dominique Mattei, «il reste à faire la part, judiciairement, entre l’espoir de faire des affaires et leur réalité ». « D’ailleurs, ajoute-t-il, Pierre Federici et son père sont ressortis libres de leur audition, et je crois que, dans ce dossier, la justice entend surtout vérifier que cette famille ne vit pas du produit du blanchiment de sommes accumulées dans le passé. »
Le Sporting Club de Bastia dans la ligne de mire
La ville de bastia est l’une des zones d’influence privilégiées des « bergers » de Venzolasca. Le fief, en Haute-Corse, de ce clan redouté sur l’ensemble de l’île. Son chef, Ange-Toussaint Federici, dit « ATF », s’en félicite, en septembre 2016, lors d’une visite au parloir de son ami Jean-Michel Fondacci à la prison d’Alençon - Condé-sur-Sarthe (Orne), où il est incarcéré. «A Bastia, tout est en règle», lui dit-il. Le club de football local, le Sporting Club de Bastia (SCB), n’échappe pas à son appétit. Les policiers soupçonnent en effet les Federici d’avoir voulu faire main basse sur cette institution insulaire.
Dès le 7 novembre2015, alors que le SCB connaît des difficultés financières – l’été précédent, il a frôlé la relégation en Ligue 2 –, « ATF » explique à son fils Pierre que c’est lui « le patron » du Sporting. Il donne ensuite la ligne à suivre auprès des dirigeants en place : transmettre ses ordres (répéter « Papa a dit comme ça »), investir sans exagération (« Tu mets la moitié de ce qu’ils t’ont dit ») et récupérer une partie de la mise (« Tu demandes 15 000 euros par mois »). Le sujet, visiblement, lui tient à cœur.
En décembre de la même année, « ATF » informe de nouveau l’un de ses cousins qu’il veut prendre le contrôle total du SCB. Mais les discussions traînent et ne sont pas si simples. En mars 2017, écrivent les policiers dans un rapport dont Le Monde a eu connaissance, il s’entretient avec un autre cousin, Paul Bastiani. Selon les enquêteurs, « ATF » se montre alors très ferme et mécontent lorsqu’il apprend que « beaucoup de monde » va discuter avec Pierre-Marie Geronimi, le président du SCB. «Le seul que j’ai autorisé, c’est Pilou [Pierre- Louis Montet, son homme de confiance] », dit-il agacé.
Dépôt de bilan et rétrogradation
La situation financière du club se dégrade. La menace d’une descente en Ligue 2, voire en National (la troisième division), se dessine. Au printemps 2017, M. Montet s’active pour chercher des financements. Il est, lui-même, en tant que dirigeant de la société de sécurité Sisis, chargée de la sécurité du Sporting, intéressé par l’avenir du club. Parmi les candidats au rachat figure Qwant, le moteur de recherche sur Internet français, qui était déjà un sponsor du SCB pour la saison 2016-2017. Selon les enquêteurs, son dirigeant, Eric Léandri, qui n’a pas donné suite aux sollicitations du Monde, assure alors qu’il est d’accord pour prendre des parts sans revendiquer une place au sein de l’état-major du club, ce qui semble convenir aux Federici.
Pierre-Marie Geronimi ne semble pas associé à ces discussions. L’été dernier, une dizaine d’entrepre- neurs, dont M. Léandri et M. Montet, tombent d’accord pour tenter de sauver le club. La police judiciaire souligne que ces éléments « calquent quasi parfaitement les propos tenus par Ange-Toussaint Federici à son cousin Paul Bastiani ». Finalement, ce projet échouera.
Si le Sporting avait été maintenu en Ligue 2 par les instances du football français, le montage était viable. Mais le club, contraint de déposer le bilan, est rétrogradé d’office en National 3 (championnat amateur), perdant ainsi son statut professionnel, ses droits télévisuels et des subventions conséquentes. D’un coup, l’intérêt des Federici décroît. La veille du dépôt de bilan, M. Montet a tout de même obtenu du président Geronimi qu’il lui verse les 130.000 euros dus par le club à la société Sisis. Une chance que n’auront pas la plupart des créanciers... Sollicité, M. Geronimi n’a pas donné suite aux sollicitations du Monde. M. Montet se défend pour sa part d’avoir « joué un grand rôle » et assure qu’en aucun cas « il n’agissait pour le compte de la famille Federici ». Il dément tout lien d’affaires avec eux et rappelle qu’il a été placé sous le statut de témoin assisté – et non de mis en examen – par les magistrats chargés de l’enquête. Selon lui, « tout cela relève d’une construction policière bâtie sur quelques bribes de phrases bien choisies ». A l’entendre, « l’influence de “Toussaint” », depuis sa prison, est « nulle »