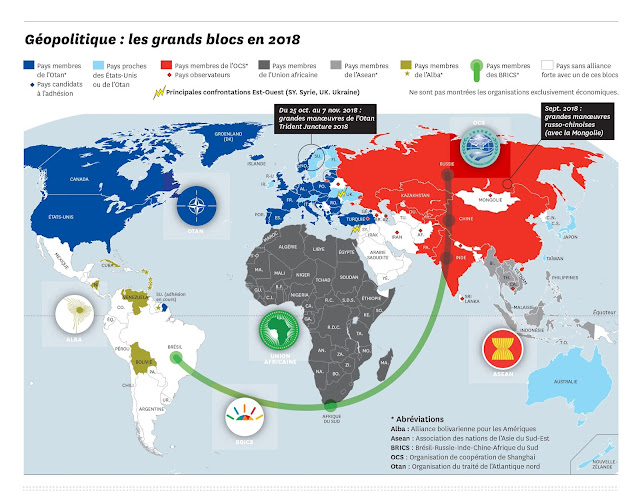07/12/2018
06/12/2018
Les cabinets d’avocats anglo-saxons, chevaux de Troie du département de la Justice
«OUI, pour nos clients français, il y a la crainte réelle ou fantasmée que la mise en conformité des entreprises par les cabinets anglo-saxons afin de lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent (procédure de compliance, NDLR) puisse s’insérer dans une guerre économique bien plus vaste contre les intérêts européens et peut-être une instrumentalisation de l’Administration américaine. La politique agressive de Donald Trump n’a pas calmé le jeu.» Avec beaucoup de précaution et sous le sceau de l’anonymat, ce dirigeant d’un cabinet français, comme tous ses confrères interrogés, lève le voile sur l’inquiétude croissante des entreprises françaises et parfois leur réticence à confier notamment ces procédures de compliance aux cabinets anglo-saxons.
Les déclarations dans Challenges, en octobre 2017, de Charles Duchaîne, le directeur de l’Agence française anticorruption n’ont pas arrangé les choses : « Il faut éviter que des cabinets d’avocats anglais ou américains s’invitent dans nos entreprises et que les décisions de justice servent de prétexte à de l’espionnage industriel. » Des recommandations qui renvoient tant au mode de fonctionnement interne des grands cabinets anglo- saxons internationaux, américains comme anglais, qu’à leur statut dans l’ordre judiciaire en cas d’investigations demandées par le tout-puissant département de la Justice.
« Certaines entreprises françaises choisiront malgré tout un cabinet anglo- saxon parce qu’elles pensent qu’un tampon américain en matière de compliance prouvera leur bonne foi. Mais il nous arrive de voir venir vers nous des clients français qui quittent leur conseil parce qu’il a rejoint un grand cabinet anglo-saxon. Ils savent que les règles du secret professionnel diffèrent. Les bureaux français peuvent-ils offrir la garantie absolue que leurs informations sensibles ne traverseront pas l’Atlantique ? », interroge cet associé d’un cabinet français. Au nom de la règle du conflit d’intérêts, tout client stratégique est adoubé par la maison mère située outre-Atlantique. Ce qui signifie un partage extensif d’information.
À cela s’ajoute une menace plus indirecte qui percute la question de la compliance, celle de la conservation des données sensibles des grandes entreprises : « Les cabinets d’avocats et de conseils, acteurs incontournables des dispositifs d’extraterritorialité juridique, ont la capacité d’identifier certaines vulnérabilités chez leurs clients et d’obtenir un accès à leurs données stratégiques », prévient la note de la DGSI. « Les grandes entreprises privées du numérique en particulier, à l’image de Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft, outre leur mainmise sur d’immenses volumes de données personnelles, déploient quant à elles une stratégie d’influence pour la mise en place de normes qui leur sont favorables. »
Les déclarations dans Challenges, en octobre 2017, de Charles Duchaîne, le directeur de l’Agence française anticorruption n’ont pas arrangé les choses : « Il faut éviter que des cabinets d’avocats anglais ou américains s’invitent dans nos entreprises et que les décisions de justice servent de prétexte à de l’espionnage industriel. » Des recommandations qui renvoient tant au mode de fonctionnement interne des grands cabinets anglo- saxons internationaux, américains comme anglais, qu’à leur statut dans l’ordre judiciaire en cas d’investigations demandées par le tout-puissant département de la Justice.
« Certaines entreprises françaises choisiront malgré tout un cabinet anglo- saxon parce qu’elles pensent qu’un tampon américain en matière de compliance prouvera leur bonne foi. Mais il nous arrive de voir venir vers nous des clients français qui quittent leur conseil parce qu’il a rejoint un grand cabinet anglo-saxon. Ils savent que les règles du secret professionnel diffèrent. Les bureaux français peuvent-ils offrir la garantie absolue que leurs informations sensibles ne traverseront pas l’Atlantique ? », interroge cet associé d’un cabinet français. Au nom de la règle du conflit d’intérêts, tout client stratégique est adoubé par la maison mère située outre-Atlantique. Ce qui signifie un partage extensif d’information.
À cela s’ajoute une menace plus indirecte qui percute la question de la compliance, celle de la conservation des données sensibles des grandes entreprises : « Les cabinets d’avocats et de conseils, acteurs incontournables des dispositifs d’extraterritorialité juridique, ont la capacité d’identifier certaines vulnérabilités chez leurs clients et d’obtenir un accès à leurs données stratégiques », prévient la note de la DGSI. « Les grandes entreprises privées du numérique en particulier, à l’image de Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft, outre leur mainmise sur d’immenses volumes de données personnelles, déploient quant à elles une stratégie d’influence pour la mise en place de normes qui leur sont favorables. »
Le«CloudAct» en ligne de mire
Qu’il s’agisse des cabinets Bredin-Prat, Gide, Darrois ou August Debouzy, pour ne citer que les plus grands, tous témoignent que la question de la sécurité informatique est devenue l’obsession de leurs grands clients qui n’hésitent pas à procéder à des audits pour vérifier l’étanchéité des systèmes informatiques de leurs avocats. La technologie du cloud dominée par les grands acteurs américains du numérique, mais aussi la nationalité des serveurs, fait frémir les industriels français. En ligne de mire notamment, le « Cloud Act » qui permet d’accéder aux données d’acteurs économiques sous le coup d’investigation de la justice américaine avec un contrôle qui paraît d’autant plus vague pour les entreprises françaises qu’elles ne le maîtrisent pas. « Nous avons notre propre parc de serveurs que nous entretenons nous-mêmes avec des systèmes d’accès qui peuvent être totalement restreints et avec une traçabilité totale », affirme, rassurant, Stéphane Puel, managing partner de Gide Loyrette Nouel.
La question est d’autant plus sensible que lors d’investigations extraterritoriales lancées par le département de la Justice, au nom d’atteintes aux intérêts américains - une simple transaction en dollars suffit - les avocats anglo-saxons changent de nature pour devenir des auxiliaires de la justice américaine pour mener des enquêtes internes aux entreprises. Un mandat qui les délie de leur secret professionnel : « Leur mission est de trouver tous les éléments qui peuvent incriminer leurs clients. Ils vont débarquer en France avec des cohortes de jeunes avocats qui vont tout éplucher pendant des mois. Ils figent les boîtes mails, emportent les ordinateurs, font des interrogatoires de collaborateurs de l’entreprise et dressent des procès-verbaux que les intéressés ne pourront pas relire. » Au point qu’en février 2016, le barreau de Paris envoie une note à tous ses avocats, rappelant que tout collaborateur d’une entreprise a droit à un avocat distinct de cette dernière lors de ces audits. « Il est vrai que l’on ne peut pas avoir moins de droits face à un avocat qui fait une enquête interne que face à un juge d’instruction », relève Christophe Ingrain associé au sein du cabinet Darrois.
Derrière ces procédures, des enjeux financiers démesurés. Car ces entreprises vont dépenser des fortunes en avocats qui font tourner les compteurs de la facturation dès qu’ils quittent le seuil de leur maison. Elles paieront ensuite des amendes records qui bénéficieront au Trésor américain. « Pour- tant, les outils de protection existent depuis 1973 » dans le droit international, souligne Hugues Calvet, associé au cabinet Bredin-Prat. « Ce sont les Blocking Statutes qui interdisent de transmettre à toute administration étrangère les données d’entreprises sensibles. Mais il est vrai qu’une réflexion s’impose tant ils sont peu utilisés. »
Jusqu’à la création des lois Sapin sur la compliance en 2016, celle de l’agence anticorruption en 2017 et du Parquet national financier (PNF) en 2013, la justice américaine avait beau jeu de justifier son intrusion dans les affaires françaises en faisant remarquer qu’il n’existait pas de système anticorruption digne de ce nom. « Avec la création de ces outils, nous avons rattrapé les standards anglo- saxons », analyse Benjamin Van Gaver, associé chez August Debouzy. Paradoxalement le PNF, à l’origine d’amendes records comme celles infligées à la Société générale le 4 juin dernier, s’impose face aux exigences de la justice américaine. Au point que, peu à peu, les entreprises françaises commencent à le saisir spontanément dès que surgit tout risque de corruption ou de blanchiment les concernant. Quitte à multiplier les nuits blanches, mais avec la certitude que les administrations étrangères ne pourront pas empiéter sur ses compétences.
La question est d’autant plus sensible que lors d’investigations extraterritoriales lancées par le département de la Justice, au nom d’atteintes aux intérêts américains - une simple transaction en dollars suffit - les avocats anglo-saxons changent de nature pour devenir des auxiliaires de la justice américaine pour mener des enquêtes internes aux entreprises. Un mandat qui les délie de leur secret professionnel : « Leur mission est de trouver tous les éléments qui peuvent incriminer leurs clients. Ils vont débarquer en France avec des cohortes de jeunes avocats qui vont tout éplucher pendant des mois. Ils figent les boîtes mails, emportent les ordinateurs, font des interrogatoires de collaborateurs de l’entreprise et dressent des procès-verbaux que les intéressés ne pourront pas relire. » Au point qu’en février 2016, le barreau de Paris envoie une note à tous ses avocats, rappelant que tout collaborateur d’une entreprise a droit à un avocat distinct de cette dernière lors de ces audits. « Il est vrai que l’on ne peut pas avoir moins de droits face à un avocat qui fait une enquête interne que face à un juge d’instruction », relève Christophe Ingrain associé au sein du cabinet Darrois.
Derrière ces procédures, des enjeux financiers démesurés. Car ces entreprises vont dépenser des fortunes en avocats qui font tourner les compteurs de la facturation dès qu’ils quittent le seuil de leur maison. Elles paieront ensuite des amendes records qui bénéficieront au Trésor américain. « Pour- tant, les outils de protection existent depuis 1973 » dans le droit international, souligne Hugues Calvet, associé au cabinet Bredin-Prat. « Ce sont les Blocking Statutes qui interdisent de transmettre à toute administration étrangère les données d’entreprises sensibles. Mais il est vrai qu’une réflexion s’impose tant ils sont peu utilisés. »
Jusqu’à la création des lois Sapin sur la compliance en 2016, celle de l’agence anticorruption en 2017 et du Parquet national financier (PNF) en 2013, la justice américaine avait beau jeu de justifier son intrusion dans les affaires françaises en faisant remarquer qu’il n’existait pas de système anticorruption digne de ce nom. « Avec la création de ces outils, nous avons rattrapé les standards anglo- saxons », analyse Benjamin Van Gaver, associé chez August Debouzy. Paradoxalement le PNF, à l’origine d’amendes records comme celles infligées à la Société générale le 4 juin dernier, s’impose face aux exigences de la justice américaine. Au point que, peu à peu, les entreprises françaises commencent à le saisir spontanément dès que surgit tout risque de corruption ou de blanchiment les concernant. Quitte à multiplier les nuits blanches, mais avec la certitude que les administrations étrangères ne pourront pas empiéter sur ses compétences.
05/12/2018
COMMENT LES AMERICAINS PROCÈDENT POUR L'ESPIONNAGE ECONOMIQUE
LES METHODES DES YANKEE
DROIT EXTRATERRITORIAL
Selon la DGSI, « l’extraterritorialité se traduit par une grande variété de lois et mécanismes juridiques conférant aux autorités américaines la capacité de soumettre des entreprises étrangères à leurs standards, mais également de capter leurs savoir-faire, d’entraver les efforts de développement des concurrents des entreprises étatsuniennes, de contrôler ou surveiller des sociétés étrangères gênantes ou convoitées, et ce faisant, de générer des revenus financiers importants ».
L’agence française ajoute : « Plusieurs grands groupes français ont ainsi été ciblés par le ministère de la Justice américain ces dernières années [...] (Technip, Total, Alstom, Alcatel, BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale).
Les opérations d’acquisition ou de fusion ayant suivi, pour certains d’entre eux, pourraient être interprétées comme le fruit de manœuvres de déstabilisation et de fragilisation rendues possibles par la mise en œuvre de ces dispositions légales. »
PROCÉDURE DE DISCOVERY
Selon la DGSI, « les entreprises américaines peuvent également utiliser des dispositifs juridiques afin de développer des stratégies judiciaires destinées à forcer leurs concurrents à divulguer des informations sensibles.
Pour éviter de devoir verser de lourdes compensations financières ou de se voir refuser l’accès
au marché de la première économie mondiale, celles-ci n’ont d’autres choix que de se mettre en conformité ». Les contre-espions français précisent que « ce risque est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit de contentieux relatifs à des questions de propriété intellectuelle ». Et de citer les déboires de la société Soitec, leader français de la fourniture de plaque de silicium, accusée de
contrefaçon. La procédure dite de « Discovery » déclenchée l’obligeait à livrer, selon eux, « la liste de ses sites de production et de ses implantations commerciales, les spécifications techniques liées
à ses produits et à leurs processus de fabrication, le matériel utilisé, les brevets détenus et le bilan
de son activité commerciale. Cette procédure constitue, de fait, un outil très efficace de captation d’informations ».
ARME DOUANIÈRE
La DGSI l’affirme : « Le contrôle douanier au passage des frontières américaines constitue un point
de vulnérabilité pour les sociétés étrangères, et singulièrement françaises. » Elle cite des exemples.
« En octobre 2015, un cadre de la société rennaise Ama, qui propose une prise en charge médicale via
des lunettes connectées et un kit spécial, avait entreposé dans ses bagages en soute
une paire de lunettes connectées et son téléphone portable. Après les avoirs récupérés, il a constaté que ces appareils avaient été fouillés et allumés par les autorités douanières américaines. » De même, « en 2016, dans le cadre de sa participation au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas consacré à l’innovation technologique en électronique grand public, lors de son passage
en douane, une entreprise française spécialisée dans le big data a vu
ses prototypes retenus sans raison pendant plusieurs heures ».
La procédure Esta de présélection des passagers voulant voyager aux États-Unis offre aussi, selon la DGSI, « des possibilités de captation d’informations sur des entreprises étrangères et leurs salariés
qui se rendent aux États-Unis ».
Les États-Unis décident de façon unilatérale d’appliquer des embargos contre certains pays. Les enfreindre, c’est prendre le risque de se fermer le marché américain. La DGSI parle d’un « procédé particulièrement dissuasif ».
Le cas iranien est cité : « Nombre d’entreprises françaises - et toutes les grandes banques – préfèrent ainsi éviter ce marché ou attendre que les concurrents américains s’y soient d’abord installés. »
Total, Peugeot, Citroën ou Renault ont ainsi jeté l’éponge par peur des représailles.
La DGSI estime que « dans le domaine cyber, le déploiement de solutions bureautiques proposées par Microsoft dans les universités et les grandes écoles françaises induit un risque accru de captation de données et d’informations sensibles ». Par ailleurs, rappelle-t-elle, depuis l’adoption du Cloud Act aux États-Unis, le 23 mars dernier, « toute entreprise américaine, quelle que soit la localisation
géographique de ses serveurs, a l’obligation de divulguer des informations aux autorités sur simple demande d’un juge fédéral, indépendamment du respect des réglementations nationales sur
la protection des données personnelles ».
qui se rendent aux États-Unis ».
RÉGLEMENTATION SUR LES EMBARGOS
Les États-Unis décident de façon unilatérale d’appliquer des embargos contre certains pays. Les enfreindre, c’est prendre le risque de se fermer le marché américain. La DGSI parle d’un « procédé particulièrement dissuasif ».
Le cas iranien est cité : « Nombre d’entreprises françaises - et toutes les grandes banques – préfèrent ainsi éviter ce marché ou attendre que les concurrents américains s’y soient d’abord installés. »
Total, Peugeot, Citroën ou Renault ont ainsi jeté l’éponge par peur des représailles.
CYBERDOMINATION
La DGSI estime que « dans le domaine cyber, le déploiement de solutions bureautiques proposées par Microsoft dans les universités et les grandes écoles françaises induit un risque accru de captation de données et d’informations sensibles ». Par ailleurs, rappelle-t-elle, depuis l’adoption du Cloud Act aux États-Unis, le 23 mars dernier, « toute entreprise américaine, quelle que soit la localisation
géographique de ses serveurs, a l’obligation de divulguer des informations aux autorités sur simple demande d’un juge fédéral, indépendamment du respect des réglementations nationales sur
la protection des données personnelles ».
La DGSI s’alarme de l’offensive contre les entreprises françaises
Dans une note à l’exécutif, elle dénonce des manœuvres destinées à piller les entreprises francaise
LE RENSEIGNEMENT TRICOLORE DÉNONCE DES INGÉRENCES: Dans sa note au gouvernement du 12 avril dernier dénonçant les « ingérences économiques américaines en France », la DGSI décrit les « modes opératoires » de l’Oncle Sam. « Sans négliger les modes opératoires conventionnels (débauchages de cadres, pseudo-négociations commerciales prétextes à des captations d’informations, dumping, etc.), la spécificité américaine réside dans le déploiement d’un arsenal juridique et réglementaire permettant de s’affranchir de la notion de frontière », écrivent les contre-espions français.
LES SECTEURS LES PLUS EXPOSÉS: Aéronautique, énergie, santé, électronique, recherche universitaire, télécommunications, nucléaire...
En 2016, deux agences liées au Pentagone [...] ont cherché à obtenir des informations sur les programmes de recherche de plusieurs établissements publics français en s’adressant directement à des chercheurs
ESPIONNAGE Méfiez-vous de vos amis. Ce pourrait être le titre d’une note du contre-espionnage français a eu connaissance. Un document de six pages, destiné à éclairer l’exécutif et daté du 12 avril dernier. Il se présente sobrement comme un « panorama des ingérences économiques américaines en France ». Mais quand la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), rattachée directement au ministre de l’Intérieur, s’empare d’un tel sujet, l’affaire prend un certain relief. Car c’est un service phare de la Place Beauvau qui alerte ici le pouvoir.
Les termes sont choisis. « Les acteurs américains déploient une stratégie de conquête des marchés à l’export qui se traduit, à l’égard de la France en particulier, par une politique offensive en faveur de leurs intérêts économiques », écrivent les analystes de la DGSI. Selon eux, « les secteurs ciblés correspondent à des domaines d’avenir présentés de longue date comme stratégiques par les autorités américaines, dont l’aéronautique, la santé et plus généralement le monde de la recherche ». Ils ajoutent : « Cette stratégie, qui vise à favoriser les entreprises américaines aux dépens de leurs concurrents étrangers, est déployée par des entités tant publiques que privées – administrations, entreprises, cabinets d’avocats et de conseil, etc. – qui œuvrent de concert et déploient un arsenal de dispositifs et mesures économiques et juridiques. »
La DGSI est sûre de son fait: «Les entreprises françaises évoluant dans ces secteurs font l’objet d’attaques ciblées, notamment par le biais de contentieux juridiques, de tentatives de captation d’informations et d’ingérence économique. » Premier secteur concerné : l’aéronautique. «Dans un contexte très concurrentiel, où les États-Unis se prêtent à des manœuvres pour favoriser Boeing sur des marchés prometteurs, le groupe Airbus connaît des difficultés conjoncturelles depuis quelques années pour plusieurs de ses programmes (A380, A320, A400M). L’avionneur européen est également vulnérable sur le plan judiciaire et cherche à se mettre en conformité afin d’éviter de lourdes sanctions », affirme l’agence de contre-espionnage de Beauvau.
À la lire, « Airbus fait actuellement l’objet d’audits de conformité en matière de lutte contre la corruption. C’est dans ce cadre qu’interviennent en son sein des cabinets d’avocats américains ». Or, s’inquiètent nos contre-espions, ces acteurs « disposent, depuis 2015, d’un accès privilégié à des données stratégiques du groupe ». Ainsi, « les informations de toutes natures saisies auprès des cadres d’Airbus permettent de cartographier tous les intermédiaires et contacts du groupe, ainsi que ses axes de développement à l’international ».
La DGSI l’affirme : plusieurs des avocats concernés « sont en contact avec des administrations américaines. Ces cabinets avaient également été missionnés par Alstom et Technip dans des procédures analogues ayant abouti à de lourdes condamnations pour les deux groupes français ».
Les sociétés de taille plus modeste ne seraient guère épargnées non plus. « Les acteurs américains, publics et privés, ont ciblé à plusieurs reprises la recherche et l’innovation françaises en proposant des financements à des organismes de recherche ou à des entreprises innovantes, afin de soutenir des programmes ou des projets de développement à l’international », constate la DGSI. En apparence, la simple logique des affaires. Mais derrière, il n’y aurait rien d’amical : « Il s’agit bien de dépecer les fleurons tricolores », regrette un préfet très au fait des questions de sécurité nationale. Selon lui, « les Américains coopèrent très fortement avec la France et les services alliés au niveau opérationnel contre le terrorisme islamique et l’espionnage chinois ou russe, mais 60 % de leur activité reste centrée sur la recherche de renseignements stratégiques. Tous les moyens sont bon pour faire vivre leur patriotisme économique ».
Ce grand commis révèle qu’«il fut un temps pas si lointain où les services américains ont été lourdement suspectés d’avoir piégé les ordinateurs de Bercy ». Concernant l’activité économique, il assure toutefois que « l’essentiel se passe en toute transparence, de façon ouverte, notamment par des prises de contact directes avec des cadres des sociétés françaises ciblées ». À l’entendre, « les interlocuteurs les séduisent, les invitent à donner des conférences, puis à rédiger des notes de plus en plus précises ». Sur les nouvelles technologies, « dès qu’une société française est en avance, les Américains la ravissent en envoyant au feu leurs puissants fonds d’investissement », assure cet homme du sérail.
La note de la DGSI ne dit pas autre chose. Elle évoque une société française vendue 12 millions de dollars à des fonds américains. « Par la suite, écrivent ses auteurs, le siège de l’entreprise et ses activités de recherche et développement ont été transférées aux États-Unis. À l’issue d’une croissance spectaculaire, la société est désormais valorisée à hauteur d’un milliard de dollars. » Du point de vue tricolore, c’est une perte. Mais c’est la loi du marché.
Que penser alors de cette autre entreprise qui développait, elle, des produits orthopédiques ? Selon la DGSI, la société française Tornier a « connu un sort comparable entre 2006 et 2015 après sa prise de contrôle par un fonds américain ». Puis elle a été « dissoute dans le cadre d’une fusion avec la firme américaine ». Perdue pour la France. En 2017, une société bretonne spécialisée dans la chirurgie de l’épaule assistée par ordinateur avait établi un partenariat. « Disposant d’une avance technologique conséquente », elle « envisageait à terme de se présenter en concurrent de son partenaire américain et était susceptible de capter 20% de son marché si le projet se concrétisait ». Mais elle n’a pas résisté aux millions de dollars mis sur la table.
Page après page se dessine l’« offensive » que les analystes de Beauvau croient déceler derrière toutes ces opérations commerciales. « La DGSI a également identifié l’intérêt marqué des acteurs économiques pour les sociétés spécialisées dans la gestion des données médicales, conduisant à l’acquisition de plusieurs sociétés françaises spécialisées dans le traitement de ce type d’informa- tions », révèle le document. Et de citer le cas de « la branche dédiée à la gestion des données clients et stratégiques de Cegedim, acquise par IMS Health en 2015 ». « Cette opération a contribué à faire de cet acteur américain la seule société au monde disposant d’une base de données aussi exhaustive », déplore la DGSI.
La conclusion n’est guère réjouissante. « Les domaines d’excellence français » seraient « particulièrement exposés », assurent ces policiers en charge de la protection du patrimoine économique. Selon eux, «les PME ne se sont pas suffisamment armées et les grands groupes français semblent également vulnérables, privilégiant des stratégies de repli et d’évitement afin de ne pas s’exposer ». Une vision bien pessimiste alors que la mondialisation poursuit sa course effrénée.
En 2016, deux agences liées au Pentagone [...] ont cherché à obtenir des informations sur les programmes de recherche de plusieurs établissements publics français en s’adressant directement à des chercheurs
ESPIONNAGE Méfiez-vous de vos amis. Ce pourrait être le titre d’une note du contre-espionnage français a eu connaissance. Un document de six pages, destiné à éclairer l’exécutif et daté du 12 avril dernier. Il se présente sobrement comme un « panorama des ingérences économiques américaines en France ». Mais quand la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), rattachée directement au ministre de l’Intérieur, s’empare d’un tel sujet, l’affaire prend un certain relief. Car c’est un service phare de la Place Beauvau qui alerte ici le pouvoir.
Les termes sont choisis. « Les acteurs américains déploient une stratégie de conquête des marchés à l’export qui se traduit, à l’égard de la France en particulier, par une politique offensive en faveur de leurs intérêts économiques », écrivent les analystes de la DGSI. Selon eux, « les secteurs ciblés correspondent à des domaines d’avenir présentés de longue date comme stratégiques par les autorités américaines, dont l’aéronautique, la santé et plus généralement le monde de la recherche ». Ils ajoutent : « Cette stratégie, qui vise à favoriser les entreprises américaines aux dépens de leurs concurrents étrangers, est déployée par des entités tant publiques que privées – administrations, entreprises, cabinets d’avocats et de conseil, etc. – qui œuvrent de concert et déploient un arsenal de dispositifs et mesures économiques et juridiques. »
La DGSI est sûre de son fait: «Les entreprises françaises évoluant dans ces secteurs font l’objet d’attaques ciblées, notamment par le biais de contentieux juridiques, de tentatives de captation d’informations et d’ingérence économique. » Premier secteur concerné : l’aéronautique. «Dans un contexte très concurrentiel, où les États-Unis se prêtent à des manœuvres pour favoriser Boeing sur des marchés prometteurs, le groupe Airbus connaît des difficultés conjoncturelles depuis quelques années pour plusieurs de ses programmes (A380, A320, A400M). L’avionneur européen est également vulnérable sur le plan judiciaire et cherche à se mettre en conformité afin d’éviter de lourdes sanctions », affirme l’agence de contre-espionnage de Beauvau.
À la lire, « Airbus fait actuellement l’objet d’audits de conformité en matière de lutte contre la corruption. C’est dans ce cadre qu’interviennent en son sein des cabinets d’avocats américains ». Or, s’inquiètent nos contre-espions, ces acteurs « disposent, depuis 2015, d’un accès privilégié à des données stratégiques du groupe ». Ainsi, « les informations de toutes natures saisies auprès des cadres d’Airbus permettent de cartographier tous les intermédiaires et contacts du groupe, ainsi que ses axes de développement à l’international ».
La DGSI l’affirme : plusieurs des avocats concernés « sont en contact avec des administrations américaines. Ces cabinets avaient également été missionnés par Alstom et Technip dans des procédures analogues ayant abouti à de lourdes condamnations pour les deux groupes français ».
« Patriotisme économique »
Les sociétés de taille plus modeste ne seraient guère épargnées non plus. « Les acteurs américains, publics et privés, ont ciblé à plusieurs reprises la recherche et l’innovation françaises en proposant des financements à des organismes de recherche ou à des entreprises innovantes, afin de soutenir des programmes ou des projets de développement à l’international », constate la DGSI. En apparence, la simple logique des affaires. Mais derrière, il n’y aurait rien d’amical : « Il s’agit bien de dépecer les fleurons tricolores », regrette un préfet très au fait des questions de sécurité nationale. Selon lui, « les Américains coopèrent très fortement avec la France et les services alliés au niveau opérationnel contre le terrorisme islamique et l’espionnage chinois ou russe, mais 60 % de leur activité reste centrée sur la recherche de renseignements stratégiques. Tous les moyens sont bon pour faire vivre leur patriotisme économique ».
Ce grand commis révèle qu’«il fut un temps pas si lointain où les services américains ont été lourdement suspectés d’avoir piégé les ordinateurs de Bercy ». Concernant l’activité économique, il assure toutefois que « l’essentiel se passe en toute transparence, de façon ouverte, notamment par des prises de contact directes avec des cadres des sociétés françaises ciblées ». À l’entendre, « les interlocuteurs les séduisent, les invitent à donner des conférences, puis à rédiger des notes de plus en plus précises ». Sur les nouvelles technologies, « dès qu’une société française est en avance, les Américains la ravissent en envoyant au feu leurs puissants fonds d’investissement », assure cet homme du sérail.
La note de la DGSI ne dit pas autre chose. Elle évoque une société française vendue 12 millions de dollars à des fonds américains. « Par la suite, écrivent ses auteurs, le siège de l’entreprise et ses activités de recherche et développement ont été transférées aux États-Unis. À l’issue d’une croissance spectaculaire, la société est désormais valorisée à hauteur d’un milliard de dollars. » Du point de vue tricolore, c’est une perte. Mais c’est la loi du marché.
Que penser alors de cette autre entreprise qui développait, elle, des produits orthopédiques ? Selon la DGSI, la société française Tornier a « connu un sort comparable entre 2006 et 2015 après sa prise de contrôle par un fonds américain ». Puis elle a été « dissoute dans le cadre d’une fusion avec la firme américaine ». Perdue pour la France. En 2017, une société bretonne spécialisée dans la chirurgie de l’épaule assistée par ordinateur avait établi un partenariat. « Disposant d’une avance technologique conséquente », elle « envisageait à terme de se présenter en concurrent de son partenaire américain et était susceptible de capter 20% de son marché si le projet se concrétisait ». Mais elle n’a pas résisté aux millions de dollars mis sur la table.
Page après page se dessine l’« offensive » que les analystes de Beauvau croient déceler derrière toutes ces opérations commerciales. « La DGSI a également identifié l’intérêt marqué des acteurs économiques pour les sociétés spécialisées dans la gestion des données médicales, conduisant à l’acquisition de plusieurs sociétés françaises spécialisées dans le traitement de ce type d’informa- tions », révèle le document. Et de citer le cas de « la branche dédiée à la gestion des données clients et stratégiques de Cegedim, acquise par IMS Health en 2015 ». « Cette opération a contribué à faire de cet acteur américain la seule société au monde disposant d’une base de données aussi exhaustive », déplore la DGSI.
La conclusion n’est guère réjouissante. « Les domaines d’excellence français » seraient « particulièrement exposés », assurent ces policiers en charge de la protection du patrimoine économique. Selon eux, «les PME ne se sont pas suffisamment armées et les grands groupes français semblent également vulnérables, privilégiant des stratégies de repli et d’évitement afin de ne pas s’exposer ». Une vision bien pessimiste alors que la mondialisation poursuit sa course effrénée.
UNE STRATÉGIE POUR LES START-UP
Pour une start-up, RapidSOS avait un argumentaire facile à comprendre : faire entrer les appels d’urgence dans l’ère du smartphone. La mise en place des systèmes d’intervention d’urgence ayant précédé l’arrivée des mobiles, la plupart avaient des difficultés à localiser correctement les appels émis par les utilisateurs de smartphones, ce qui allongeait les délais d’intervention et aggravait les diagnostics.
Les fondateurs de RapidSOS, Michael Martin, diplômé de la Harvard Business School, et Nick Horelik, ingénieur du MIT, avaient développé un moyen de communiquer aux services d’urgence l’origine des appels passés par mobiles, système qui nécessitait un minimum d’adaptation
de la part des acteurs du secteur. Après avoir levé les premiers fonds lors de concours de business plans, Michael Martin et Nick Horelik se sont trouvés face à un dilemme : comment mettre leur technologie sur le marché ?
La réponse n’était pas évidente : ils ont en effet identifié quatre pistes possibles (voir l’encadré « La boussole de la stratégie entrepreneuriale »). Ils pouvaient être follement ambitieux et oser faire table rase des systèmes d’intervention d’urgence existants, en créant un « Uber des ambulances ». Ils pouvaient tenter une stratégie de disruption classique : cibler d’abord des populations mal prises en charge, comme les personnes atteintes d’épilepsie, avec l’intention de s’étendre ultérieurement à une clientèle plus large. Ils pouvaient également éviter la concurrence frontale, soit en aidant des acteurs de l’urgence à se moderniser en travaillant, par exemple, avec des fournisseurs d’équipement comme Motorola, soit en s’associant avec des compagnies d’assurances qui prennent en charge in fine le coût du service d’ambulance.
De nombreux entrepreneurs, naviguant dans le brouillard de l’incertitude, craignent que cette exploration ne retarde la commercialisation. Dès lors, ils optent pour la première stratégie qui leur vient à l’esprit, se moquant de la réflexion et de la planification qui accompagnent une stratégie mûrement réfléchie. C’est le célèbre mot de Richard Branson : « A la fin, tu te dis : on s’en fout, y a qu’à le faire ; tentons le coup. »
Il arrive que cette approche fonctionne, bien sûr. Mais, en général, ce genre d’expérimentation sur le tas est à éviter, même lorsqu’elle requiert peu de ressources. Les entrepreneurs qui s’engagent sur la première piste prometteuse entrevue fragilisent leur start-up face à des concurrents qui empruntent une voie commerciale moins évidente, mais en fin de compte plus efficace pour atteindre leurs clients. Shai Agassi, par exemple, a dépensé près d’un milliard de dollars pour bâtir un écosystème autour de Better Place, son système de « batteries échangeables » pour le segment des voitures électriques. L’approche plus réfléchie et progressive d’Elon Musk, consistant à développer une Tesla intégrée et extrêmement fiable, s’est avérée une meilleure stratégie.
Et ce n’est pas le seul problème d’une philosophie qui privilégie l’action. Les créateurs apparaissent plus sûrs d’eux et convaincants aux yeux des investisseurs, des salariés et des partenaires lorsque plusieurs stratégies démontrent le potentiel de leur idée : cela en valide la force et les hypothèses de base.
Est-il possible d’explorer des choix stratégiques sans trop ralentir le processus ? Après avoir étudié et accompagné des centaines de start-up au cours des vingt dernières années, nous avons développé une méthode baptisée « la boussole de la stratégie entrepreneuriale » ; elle permet aux créateurs d’entreprises de clarifier de façon pratique les choix critiques qui se présentent à eux. Cette boussole décrit quatre stratégies génériques de mise sur le marché qui méritent d’être étudiées au moment de passer de l’idée à son lancement, chacune offrant une manière différente de créer et de s’approprier de la valeur.
LA BOUSSOLE DE LA STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE
Au cœur de notre approche, il y a la prise de conscience que, quelle que soit l’innovation, une stratégie de mise sur le marché entraîne des choix de clientèle, de technologies, d’identité organisationnelle et de positionnement concurrentiel (voir l’encadré « Les quatre décisions »). Pour compliquer les choses, ces décisions sont interdépendantes : le choix de clientèle influe sur celui d’une identité organisationnelle et sur celui de ses technologies.
Pour les entreprises dotées de ressources, ces quatre décisions impliquent d’analyser des données dont elles disposent probablement déjà. Elles ont aussi les moyens de mener des études de marché et des expériences sur plusieurs fronts. Enfin, elles possèdent le bénéfice de l’expérience. En revanche, une start-up ayant peu de moyens manque d’expérience et des connaissances que celle-ci apporte. Cela peut toutefois être un avantage, car l’expérience, les données historiques et les engagements qui alimentent les pratiques existantes créent parfois des angles morts chez les entreprises établies, au risque de leur faire négliger des innovations dangereuses pour leur existence. Néanmoins, lorsque les sociétés en place prendront conscience des innovations, les start-up finiront par se heurter à la concurrence. De plus, elles subiront à coup sûr la pression d’autres start-up cherchant à les devancer sur le marché.
Les entrepreneurs se sentent parfois submergés par l’éventail des choix qui se présentent à eux, même si certaines pistes seront écartées car impraticables, tandis que d’autres s’articuleront mal au projet. Notre recherche laisse toutefois penser que les quatre catégories de la boussole rendent le processus gérable, en indiquant rapidement aux jeunes entreprises des stratégies efficaces de mise sur le marché et en mettant en évidence les hypothèses qui éclaireront leurs choix.
Afin de faire le tri parmi les stratégies potentielles, chaque nouvelle entreprise doit envisager deux alternatives compétitives précises :
Collaborer ou concurrencer ? Travailler avec des acteurs établis procure un accès aux ressources et aux supply chains permettant aux start-up d’attaquer plus vite un marché plus vaste et plus mature. Mais l’entreprise est susceptible de connaître des retards importants en raison de la bureaucratie propre aux grands groupes ; elle risque aussi de n’obtenir qu’une petite part d’un gâteau potentiellement plus grand (l’opérateur historique aura probablement un pouvoir de négociation plus élevé dans la relation, surtout s’il peut s’approprier des composants clés de l’idée de la start-up.)
L’inverse présente également des avantages et des inconvénients. Concurrencer des acteurs établis sur un secteur donne à la start-up davantage de liberté pour développer sa propre chaîne de valeur, travailler avec les clients que les opérateurs historiques ont peut-être négligés et apporter au marché des innovations qui améliorent la valeur pour les clients, tout en supplantant des produits qui marchent déjà. Toutefois, cela implique de s’attaquer à des concurrents disposant de ressources financières plus importantes et d’une infrastructure économique déjà en place.
Se retrancher ou attaquer ? Certaines entreprises pensent avoir davantage à gagner en conservant un contrôle strict de leur produit ou de leur technologie et que l’imitation les fragilisera. C’est pourquoi elles investissent dans la protection de la propriété intellectuelle. Une protection de la propriété intellectuelle (PI) en bonne et due forme, quoique onéreuse, permet à une start-up technologique de s’extraire d’une concurrence frontale ou d’obtenir un important levier de négociation dans les discussions avec un partenaire de supply chain. Mais privilégier le contrôle augmente les coûts de transaction et les difficultés liées à la mise sur le marché d’une innovation ainsi qu’à la collaboration avec les clients et les partenaires.
En revanche, privilégier une entrée rapide sur le marché accélère la commercialisation et le développement qui se déroulent généralement en collaboration étroite avec les partenaires et les clients. Les start-up choisissant cette voie donnent la priorité à l’expérimentation et à l’itération de leurs idées directement sur le marché. Alors qu’une stratégie bâtie sur le contrôle est susceptible de retarder l’entrée sur le marché, les start-up qui s’attachent à y pénétrer s’attendent à la concurrence et comptent sur leur agilité pour réagir quand la concurrence menace. Elles bougent vite et font des dégâts.
Répondre à ces deux questions simplifie grandement le processus de réflexion stratégique. Plutôt que de composer un menu à la carte correspondant à une idée donnée, l’équipe fondatrice évaluera son potentiel de création et d’appropriation de valeur à partir des options envisageables au sein de chaque stratégie.
A présent, examinons ces quatre stratégies.
Dans ce quadrant de la boussole, l’entreprise collabore avec les sociétés installées en conservant le contrôle sur ses produits ou ses technologies. La start-up se concentre sur la production et le développement d’idées en s’épargnant le coût des activités en aval en contact direct avec les clients. L’idée-force doit apporter de la valeur aux clients des opérateurs historiques ; par conséquent, les choix de développement dicteront celui des partenaires les plus adaptés à la nouvelle entreprise.
De plus, comme la coopération requiert un alignement sur les activités des entreprises installées, la start-up choisira probablement d’investir dans des technologies généralisables, compatibles avec les systèmes en place. Enfin, son identité (une sorte de fabrique à idées) se reflétera dans le développement d’innovations qui parviendront sur le marché par le truchement de sociétés choisies. Mais elle développera un petit nombre de technologies modulaires ayant un impact important sur le secteur et ne se lancera pas dans l’expérimentation désordonnée de chaque nouvelle technologie potentielle.
L’entreprise Dolby, spécialiste du son, en est la parfaite illustration. Quiconque recherche un système stéréo ou regarde un film au cinéma tombe forcément sur la marque Dolby. Les technologies de réduction de bruit inventées par Ray Dolby en 1965 et brevetées par les Laboratoires Dolby sont devenues une norme internationale, numéro 1 du marché depuis cinquante ans. On leur attribue l’augmentation de l’intensité émotionnelle de films emblématiques comme « Orange mécanique », de Stanley Kubrick, et « La Guerre des étoiles », de George Lucas. Pourtant, Dolby a atteint plusieurs milliards de dollars de valorisation en ayant très peu de contacts avec les réalisateurs, les producteurs de musique et les audiophiles. L’entreprise a licencié sa technologie propriétaire auprès de nombreux concepteurs et fabricants de produits dont Sony, Bose, Apple et Yamaha.
Les entrepreneurs qui choisissent une stratégie semblable à celle de Dolby prennent l’entretien et la protection de leur propriété intellectuelle très au sérieux. Des brevets et des marques conçus avec soin et gérés en lien avec une solide R & D peuvent produire des défenses puissantes, permettant à la start-up de préserver longtemps son pouvoir de négociation. Cette stratégie impose des choix de culture et de compétences. La start-up doit investir dans les bonnes compétences de R & D mais aussi auprès de juristes intelligents et impliqués. La stratégie PI s’est avérée efficace sur des niches comme Dolby et des secteurs entiers comme les biotechnologies, mais également pour des plates-formes technologiques de pointe comme Qualcomm et des intermédiaires de marché comme Getty Images.
Cette stratégie est le pôle inverse de la stratégie PI. Il s’agit de concurrencer directement les entreprises installées en mettant l’accent sur la commercialisation de l’idée et la croissance rapide de ses parts de marché plutôt que sur le contrôle de son développement. Les entrepreneurs disruptifs ont pour objectif de redéfinir les chaînes de valeur en place et les entreprises qui les dominent. Mais la nature même de la disruption permet à d’autres de prendre un chemin identique. C’est pourquoi la capacité de prendre les devants et de rester en tête est au cœur de cette stratégie.
Bien que le terme « disruption » évoque l’idée de chaos, le but premier de l’entrepreneur est en réalité d’éviter de tenter le diable et de provoquer une réaction violente (et potentiellement fatale). La start-up s’efforcera de développer rapidement capacités, ressources et fidélité des clients afin que, au réveil des opérateurs historiques, elle ait pris assez d’avance pour ne pas être rattrapée par les imitateurs.
Par conséquent, le choix des premiers clients est en général un segment de niche, souvent mal servi par les groupes installés et absent de leur radar. Cela permet à la start-up de gagner en crédibilité et d’explorer (avant qu’on ne s’en aperçoive) de nouvelles technologies pouvant présenter des défauts, mais aussi de vraies perspectives d’amélioration. Si ces technologies font la preuve de leur fiabilité, les opérateurs historiques (dont les capacités et les engagements sont organisés autour de technologies éprouvées) auront généralement du mal à les adopter.
L’identité de l’entrepreneur disruptif reflète l’énergie et la vivacité. La start-up emploie des jeunes
affamés (et pas seulement de nouilles instantanées). Elle ne craint pas la violence de la concurrence à venir ; au contraire, elle est impatiente de croiser le fer. Elle doit être agile et réactive. Et elle est obnubilée par la croissance.
Netflix est emblématique de ce quadrant. Exaspérés par les amendes pour retard infligées par les loueurs de vidéo, ses fondateurs, Marc Randolph et Reed Hastings, ont imaginé une solution qui exploiterait la technologie alors balbutiante des DVD. Après avoir testé leur idée en envoyant un DVD par courrier, ils ont créé, à la fin des années 1990, un service permettant aux cinéphiles (de préférence au grand public intéressé surtout par les dernières superproductions) de recevoir et de renvoyer leurs films de cette façon. La stratégie de Netflix était d’exploiter la « longue traîne » des contenus (low cost) et de développer un moteur de recommandations qui renforcerait les relations clients, favorisant ainsi le développement d’une nouvelle méthode de location de films qui périmerait le modèle en dur de Blockbuster (Blockbuster a d’abord snobé Netflix, lui reprochant de négliger le grand public, puis la chaîne a vu les marges de ses magasins s’effondrer avant de disparaître).
Rent the Runway utilise la stratégie de disruption pour transformer le marché vestimentaire féminin haut de gamme. Deux titulaires d’un MBA de Harvard, Jennifer Hyman et Jennifer Fleiss, ont fondé l’entreprise en 2009 après avoir repéré le problème des fashionistas qui achetaient des robes qu’elles ne mettraient qu’une seule fois. Rent the Runway a développé un site Web offrant aux femmes ambitieuses la possibilité de louer plutôt que d’acheter des marques de designers et s’est attachée à résoudre les défis opérationnels et logistiques posés par les envois et retours de vêtements. Bien que la société n’ait pas encore délogé Neiman Marcus (une chaîne de grands magasins de luxe) et d’autres acteurs plus traditionnels qui s’adressent aux clientes fortunées de la haute couture en quête d’une expérience personnalisée en magasin, elle a créé une base de clientèle fidèle qui s’est fait la porte-parole de la marque sur les réseaux sociaux. Sa croissance extraordinaire témoigne de la puissance de l’exécution face à des acteurs traditionnels moins agiles.
La disruption est enthousiasmante ; à côté, une stratégie de chaîne de valeur peut sembler banale. La start-up investit dans la commercialisation et le renforcement de la compétitivité au jour le jour plutôt
que dans le contrôle du nouveau produit et l’établissement de barrières d’entrée, mais son objectif est de s’insérer dans une chaîne de valeur existante plutôt que de viser son renversement.
Une approche banale peut néanmoins donner naissance à une affaire très lucrative. Prenons Foxconn, fabricant chinois d’électronique, l’une des rares entreprises mondiales capables d’industrialiser et de livrer dans les délais les nouveaux produits d’Apple et d’autres groupes. L’identité de ces sociétés se forge davantage dans les compétences que dans la concurrence agressive. Et quoique les entrepreneurs en chaîne de valeur soient guidés par les clients et la technologie d’autres entreprises, ils s’appliquent à développer des talents rares et des capacités sur mesure pour devenir des partenaires privilégiés.
La stratégie de chaîne de valeur est accessible à la plupart des start-up. Tandis que le supermarché en ligne Webvan, fondé en 1996, tentait de disrupter le secteur de la distribution, Peapod devenait l’épicerie Internet américaine numéro 1 en apportant un complément à valeur ajoutée aux distributeurs traditionnels (Webvan a fait faillite en 2001).
Un partenariat précoce avec le distributeur agroalimentaire Jewel-Osco, près de Chicago, a permis à Peapod de repérer ses clientes idéales (des femmes actives) et ce qu’elles appréciaient le plus (la possibilité, entre autres, de passer régulièrement commande et de fixer l’heure de livraison). Tandis que la stratégie de disruption de Webvan supposait de revoir de fond en comble l’expérience des courses, l’approche plus pointue de Peapod lui permettait de développer une offre de valeur précieuse pour des clientes prêtes à payer plus cher des commandes et des livraisons automatisées, prestation qui a débouché sur un partenariat profitable avec la chaîne de supermarchés Stop & Shop. Peapod a accumulé le savoir-faire et développé les compétences spécifiques grâce auxquelles il est en tête du secteur de l’épicerie en ligne depuis près de vingt ans.
Les entrepreneurs qui adoptent l’approche de Peapod créent et s’approprient de la valeur en visant une seule tranche « horizontale » de la chaîne de valeur sur laquelle leur expertise et leurs compétences sont inégalables. Dans aucune autre stratégie entrepreneuriale le rôle de l’équipe fondatrice ne semble plus important. En plus de l’embauche de commerciaux orientés client final ou d’ingénieurs capables d’améliorer techniquement le produit, elle doit pouvoir intégrer des innovateurs, des responsables du développement et des partenaires de la supply chain.
Les capacités de la start-up devront se traduire par une meilleure différenciation ou par un avantage coût pour les entreprises en place. Et même si l’innovation améliore en effet la position concurrentielle de l’ensemble de la chaîne de valeur, la nouvelle société ne s’imposera que si d’autres acteurs de la chaîne sont incapables de reproduire la valeur qu’elle aura créée.
Tandis que la stratégie de la chaîne valeur est le domaine des réussites discrètes, les entrepreneurs qui font le choix, avec succès, de la stratégie architecturale, tendent à être très médiatisés. Cette stratégie permet aux start-up d’être à la fois compétitives et maîtresses de la situation, mais elle est inapplicable pour de nombreuses idées, voire pour la plupart, et extrêmement risquée lorsqu’elle est exécutable. C’est le terrain de jeu de Facebook et de Google.
Les entrepreneurs qui s’engagent dans une stratégie architecturale conçoivent une chaîne de valeur absolument inédite, puis en contrôlent tous les points clés. Ils ne sont pas forcément les inventeurs des technologies sous-jacentes (il y avait des moteurs de recherche avant Google et des réseaux sociaux avant Facebook), mais ils les rendent accessibles au grand public en prenant soin de mettre en cohérence les choix de clientèle, de technologie et d’identité. Face- book s’est engagée très tôt à ne pas facturer ses utilisateurs alors même que la dynamique du média social les enchaînerait à la plateforme. Google a pris pour devise « Ne soyez pas malveillants » afin de s’imposer sans subir les résistances qui ont affecté d’autres entreprises informatiques, à l’instar d’IBM ou de Microsoft. Mais, dans chaque cas, on a supprimé des possibilités de retournement. Autrement dit, les risques pour les entrepreneurs architecturaux proviennent du fait qu’ils n’ont qu’une seule cartouche à tirer pour toucher le gros lot (rappelez-vous la triste histoire de Segway.)
Il n’est donc pas surprenant que les entrepreneurs architecturaux finissent souvent par bâtir des plate- formes plutôt que des produits. Bien que les platesformes puissent être commercialisées avec les autres stratégies, si leur centre névralgique est inaccessible, l’entrepreneur est susceptible de contrôler une nouvelle chaîne de valeur.
Prenons l’exemple d’OpenTable, un service de réservation de restaurants en ligne fondé en 1998 par
Chuck Templeton. Motivé par le défi de simplifier les réservations par téléphone, ce dernier a fait l’hypothèse qu’en plus d’offrir une plateforme de réservation, un intermédiaire en ligne efficace aurait à résoudre le problème de gestion des couverts. Il a donc décidé de développer un système qui combinerait réservations et logiciel de gestion de plan de salle, ce qui le mettait en concurrence directe avec les fournisseurs traditionnels des points de vente comme IBM et NCR.
Comme le rappelle Chuck Templeton, OpenTable ressemblait à ses débuts « à ce fil électrique unique qui court entre les poutres pour fournir lumière et connexion ». Pour amener le marché à sa start-up, il cibla d’abord les restaurants les plus en vue. « Nous avons réussi à avoir les vingt principaux restaurants de San Francisco, explique-t-il, et les cinquante autres ont voulu en être, eux aussi. On a commencé à atteindre la masse critique pour le site. » Chuck Templeton a réorganisé la chaîne de valeur du secteur de la restauration de sorte que l’exploitation des établissements soit intégrée au premier contact que les clients avaient avec eux, c’est-à-dire dès la phase de réservation. Open- Table a pris le contrôle de précieuses données propriétaires sur les préférences et exigences des clients et a établi une plateforme difficile à détrôner, faisant partie de la « panoplie » de tout nouveau restaurateur. Cette domination explique les 2,6 milliards de dollars déboursés par Priceline pour l’acquérir en 2014.
Voyons à présent comment les entrepreneurs peuvent utiliser la boussole stratégique pour choisir parmi les quatre approches de base.
La première étape consiste à compléter autant de quadrants que possible par des options stratégiques. La tâche n’est pas aisée. Cela suppose de réunir des informations supplémentaires et d’expérimenter jusqu’à un certain point (mais les engagements doivent rester modestes jusqu’à ce qu’un choix soit fait).
On trouvera des approches particulièrement efficaces pour les start-up dans « The Lean Startup », d’Eric Ries, « Business Model Generation », d’Alexander Os- terwalder et Yves Pigneur, et « Disciplined Entrepre- neurship », de Bill Aulet. Toutefois, quelle que soit la méthode choisie, celle-ci doit inclure un processus explicite de construction d’hypothèses et de test, comme l’ont élégamment souligné A.G. Lafley, Roger L. Martin, Jan W. Rivkin et Nicolaj Siggelkow dans « Bringing Science to the Art of Strategy » (HBR édition américaine, septembre 2012).
Ce processus apporte un minimum d’éclairages essentiels sur les contraintes clés associées à chaque direction indiquée par la boussole. Certains choix peuvent être écartés, faute de faisabilité ou de cohérence avec les compétences de l’équipe fondatrice. Dans d’autres cas, les exigences (en termes de capitaux, d’engagement et de vitesse) seront assez claires pour permettre à la start-up de se concentrer dessus afin de faire réussir la stratégie choisie.
Une fois les alternatives identifiées, comment l’entrepreneur doit-il procéder pour choisir ? Revenons à RapidSOS. Discutant des prochaines étapes de leur idée (l’accès aux systèmes d’intervention d’urgence par téléphone mobile), ils utilisèrent la boussole pour identifier quatre stratégies. Comme nous l’avons dit plus haut, ils avaient le choix entre une stratégie architecturale visant à remplacer les systèmes en place par un « Uber des ambulances » ; une stratégie de propriété intellectuelle afin de collaborer avec les acteurs des systèmes d’urgence déjà en place ; une stratégie de chaîne de valeur pour travailler avec les compagnies d’assurances et d’autres partenaires en lien direct avec les consommateurs, devenant ainsi une fonctionnalité d’une application d’entreprise ; ou encore une stratégie de disruption afin de se spécialiser sur un segment de clientèle étroit pour qui l’intervention d’urgence est une priorité (les épileptiques, par exemple) et de s’associer à des associations de malades pour répondre à leurs besoins.
Pour chaque quadrant de la boussole, l’entreprise identifia la clientèle à cibler, la technologie à privilégier, l’identité à revêtir et les concurrents à affronter, ainsi que la manière de le faire. Les quatre voies apparaissaient plausibles, ce qui validait solidement l’idée des fondateurs. S’il n’existe qu’une seule vision viable de l’avenir, c’est que le projet manque sans doute de substance économique.
Disposer de plusieurs options solides n’est pas nécessairement paralysant. L’entrepreneur aura simplement à choisir la stratégie la plus cohérente avec son objectif initial. La mission de RapidSOS d’améliorer le service à l’intention de groupes de malades précis conduisit l’équipe à privilégier avec beaucoup de conviction une stratégie de disruption. Cet engagement que Michael Martin et Nick Horelik étaient en mesure de transmettre avec passion et détermination les aida à convaincre les malades et les partenaires du secteur des urgences, permettant à RapidSOS d’étendre en deux ans sa technologie à l’ensemble du marché.
L’équipe fondatrice ne se contente pas de faire un choix, elle doit l’assumer. La cohérence entre la stratégie et la mission est essentielle pour motiver les créateurs et convaincre les premiers partenaires de s’engager sur cette voie. Soyons clairs : faire un choix exige de s’y impliquer, mais ne ferme pas les autres voies. La décision de RapidSOS de s’adresser à la fois aux associations de malades et aux acteurs des interventions d’urgence a réduit la probabilité qu’elle court-circuite les systèmes d’appel traditionnels, à moyen terme du moins. Mais s’adresser aux associations de malades a favorisé l’engagement des utilisateurs finaux, ce qui, avec le temps, a engendré des collaborations fructueuses et attiré des investissements de la part d’acteurs mieux installés, comme Motorola.
Cela dit, chaque stratégie affecte les éventuels changements de cap (ou pivots) ; chacune en supprime certains et en ajoute d’autres. L’entreprise doit en être consciente afin d’éviter de futurs surcoûts, tout en ménageant des occasions de passer du stade de la start-up à celui du changement d’échelle.
LA BOUSSOLE DE LA STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE n’élimine ni ne réduit l’incertitude inhérente au lancement d’une start-up. En revanche, elle fournit un cadre cohérent pour échapper aux perceptions du paysage existant et identifier d’autres environnements possibles parmi lesquels choisir. Le verbe « choisir » est essentiel ici. Lorsqu’une start-up affronte la concurrence avec de nouveaux produits qui n’apportent pas d’innovation conséquente, son succès est largement déterminé par la manière dont l’environnement affecte ses choix stratégiques. Chez les opérateurs historiques, le gagnant est en général celui qui comprend le mieux l’environnement. Mais les entrepreneurs qui apportent une véritable nouveauté ont l’occasion de remodeler le paysage, voire, comme l’a fait Dolby, d’en dessiner une partie qu’ils détiendront ou, comme Amazon, de créer une réalité entièrement nouvelle. Le choix leur appartient en grande partie. Notre matrice est conçue pour les aider à faire le bon et à mettre leur imagination et leur implication au service de la concrétisation de leur idée.
Est-il possible d’explorer des choix stratégiques sans trop ralentir le processus ? Après avoir étudié et accompagné des centaines de start-up au cours des vingt dernières années, nous avons développé une méthode baptisée « la boussole de la stratégie entrepreneuriale » ; elle permet aux créateurs d’entreprises de clarifier de façon pratique les choix critiques qui se présentent à eux. Cette boussole décrit quatre stratégies génériques de mise sur le marché qui méritent d’être étudiées au moment de passer de l’idée à son lancement, chacune offrant une manière différente de créer et de s’approprier de la valeur.
LA BOUSSOLE DE LA STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE
Au cœur de notre approche, il y a la prise de conscience que, quelle que soit l’innovation, une stratégie de mise sur le marché entraîne des choix de clientèle, de technologies, d’identité organisationnelle et de positionnement concurrentiel (voir l’encadré « Les quatre décisions »). Pour compliquer les choses, ces décisions sont interdépendantes : le choix de clientèle influe sur celui d’une identité organisationnelle et sur celui de ses technologies.
Pour les entreprises dotées de ressources, ces quatre décisions impliquent d’analyser des données dont elles disposent probablement déjà. Elles ont aussi les moyens de mener des études de marché et des expériences sur plusieurs fronts. Enfin, elles possèdent le bénéfice de l’expérience. En revanche, une start-up ayant peu de moyens manque d’expérience et des connaissances que celle-ci apporte. Cela peut toutefois être un avantage, car l’expérience, les données historiques et les engagements qui alimentent les pratiques existantes créent parfois des angles morts chez les entreprises établies, au risque de leur faire négliger des innovations dangereuses pour leur existence. Néanmoins, lorsque les sociétés en place prendront conscience des innovations, les start-up finiront par se heurter à la concurrence. De plus, elles subiront à coup sûr la pression d’autres start-up cherchant à les devancer sur le marché.
Les entrepreneurs se sentent parfois submergés par l’éventail des choix qui se présentent à eux, même si certaines pistes seront écartées car impraticables, tandis que d’autres s’articuleront mal au projet. Notre recherche laisse toutefois penser que les quatre catégories de la boussole rendent le processus gérable, en indiquant rapidement aux jeunes entreprises des stratégies efficaces de mise sur le marché et en mettant en évidence les hypothèses qui éclaireront leurs choix.
Afin de faire le tri parmi les stratégies potentielles, chaque nouvelle entreprise doit envisager deux alternatives compétitives précises :
Collaborer ou concurrencer ? Travailler avec des acteurs établis procure un accès aux ressources et aux supply chains permettant aux start-up d’attaquer plus vite un marché plus vaste et plus mature. Mais l’entreprise est susceptible de connaître des retards importants en raison de la bureaucratie propre aux grands groupes ; elle risque aussi de n’obtenir qu’une petite part d’un gâteau potentiellement plus grand (l’opérateur historique aura probablement un pouvoir de négociation plus élevé dans la relation, surtout s’il peut s’approprier des composants clés de l’idée de la start-up.)
L’inverse présente également des avantages et des inconvénients. Concurrencer des acteurs établis sur un secteur donne à la start-up davantage de liberté pour développer sa propre chaîne de valeur, travailler avec les clients que les opérateurs historiques ont peut-être négligés et apporter au marché des innovations qui améliorent la valeur pour les clients, tout en supplantant des produits qui marchent déjà. Toutefois, cela implique de s’attaquer à des concurrents disposant de ressources financières plus importantes et d’une infrastructure économique déjà en place.
Se retrancher ou attaquer ? Certaines entreprises pensent avoir davantage à gagner en conservant un contrôle strict de leur produit ou de leur technologie et que l’imitation les fragilisera. C’est pourquoi elles investissent dans la protection de la propriété intellectuelle. Une protection de la propriété intellectuelle (PI) en bonne et due forme, quoique onéreuse, permet à une start-up technologique de s’extraire d’une concurrence frontale ou d’obtenir un important levier de négociation dans les discussions avec un partenaire de supply chain. Mais privilégier le contrôle augmente les coûts de transaction et les difficultés liées à la mise sur le marché d’une innovation ainsi qu’à la collaboration avec les clients et les partenaires.
En revanche, privilégier une entrée rapide sur le marché accélère la commercialisation et le développement qui se déroulent généralement en collaboration étroite avec les partenaires et les clients. Les start-up choisissant cette voie donnent la priorité à l’expérimentation et à l’itération de leurs idées directement sur le marché. Alors qu’une stratégie bâtie sur le contrôle est susceptible de retarder l’entrée sur le marché, les start-up qui s’attachent à y pénétrer s’attendent à la concurrence et comptent sur leur agilité pour réagir quand la concurrence menace. Elles bougent vite et font des dégâts.
Répondre à ces deux questions simplifie grandement le processus de réflexion stratégique. Plutôt que de composer un menu à la carte correspondant à une idée donnée, l’équipe fondatrice évaluera son potentiel de création et d’appropriation de valeur à partir des options envisageables au sein de chaque stratégie.
A présent, examinons ces quatre stratégies.
LA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dans ce quadrant de la boussole, l’entreprise collabore avec les sociétés installées en conservant le contrôle sur ses produits ou ses technologies. La start-up se concentre sur la production et le développement d’idées en s’épargnant le coût des activités en aval en contact direct avec les clients. L’idée-force doit apporter de la valeur aux clients des opérateurs historiques ; par conséquent, les choix de développement dicteront celui des partenaires les plus adaptés à la nouvelle entreprise.
De plus, comme la coopération requiert un alignement sur les activités des entreprises installées, la start-up choisira probablement d’investir dans des technologies généralisables, compatibles avec les systèmes en place. Enfin, son identité (une sorte de fabrique à idées) se reflétera dans le développement d’innovations qui parviendront sur le marché par le truchement de sociétés choisies. Mais elle développera un petit nombre de technologies modulaires ayant un impact important sur le secteur et ne se lancera pas dans l’expérimentation désordonnée de chaque nouvelle technologie potentielle.
L’entreprise Dolby, spécialiste du son, en est la parfaite illustration. Quiconque recherche un système stéréo ou regarde un film au cinéma tombe forcément sur la marque Dolby. Les technologies de réduction de bruit inventées par Ray Dolby en 1965 et brevetées par les Laboratoires Dolby sont devenues une norme internationale, numéro 1 du marché depuis cinquante ans. On leur attribue l’augmentation de l’intensité émotionnelle de films emblématiques comme « Orange mécanique », de Stanley Kubrick, et « La Guerre des étoiles », de George Lucas. Pourtant, Dolby a atteint plusieurs milliards de dollars de valorisation en ayant très peu de contacts avec les réalisateurs, les producteurs de musique et les audiophiles. L’entreprise a licencié sa technologie propriétaire auprès de nombreux concepteurs et fabricants de produits dont Sony, Bose, Apple et Yamaha.
Les entrepreneurs qui choisissent une stratégie semblable à celle de Dolby prennent l’entretien et la protection de leur propriété intellectuelle très au sérieux. Des brevets et des marques conçus avec soin et gérés en lien avec une solide R & D peuvent produire des défenses puissantes, permettant à la start-up de préserver longtemps son pouvoir de négociation. Cette stratégie impose des choix de culture et de compétences. La start-up doit investir dans les bonnes compétences de R & D mais aussi auprès de juristes intelligents et impliqués. La stratégie PI s’est avérée efficace sur des niches comme Dolby et des secteurs entiers comme les biotechnologies, mais également pour des plates-formes technologiques de pointe comme Qualcomm et des intermédiaires de marché comme Getty Images.
LA STRATÉGIE DE DISRUPTION
Cette stratégie est le pôle inverse de la stratégie PI. Il s’agit de concurrencer directement les entreprises installées en mettant l’accent sur la commercialisation de l’idée et la croissance rapide de ses parts de marché plutôt que sur le contrôle de son développement. Les entrepreneurs disruptifs ont pour objectif de redéfinir les chaînes de valeur en place et les entreprises qui les dominent. Mais la nature même de la disruption permet à d’autres de prendre un chemin identique. C’est pourquoi la capacité de prendre les devants et de rester en tête est au cœur de cette stratégie.
Bien que le terme « disruption » évoque l’idée de chaos, le but premier de l’entrepreneur est en réalité d’éviter de tenter le diable et de provoquer une réaction violente (et potentiellement fatale). La start-up s’efforcera de développer rapidement capacités, ressources et fidélité des clients afin que, au réveil des opérateurs historiques, elle ait pris assez d’avance pour ne pas être rattrapée par les imitateurs.
Par conséquent, le choix des premiers clients est en général un segment de niche, souvent mal servi par les groupes installés et absent de leur radar. Cela permet à la start-up de gagner en crédibilité et d’explorer (avant qu’on ne s’en aperçoive) de nouvelles technologies pouvant présenter des défauts, mais aussi de vraies perspectives d’amélioration. Si ces technologies font la preuve de leur fiabilité, les opérateurs historiques (dont les capacités et les engagements sont organisés autour de technologies éprouvées) auront généralement du mal à les adopter.
L’identité de l’entrepreneur disruptif reflète l’énergie et la vivacité. La start-up emploie des jeunes
affamés (et pas seulement de nouilles instantanées). Elle ne craint pas la violence de la concurrence à venir ; au contraire, elle est impatiente de croiser le fer. Elle doit être agile et réactive. Et elle est obnubilée par la croissance.
Netflix est emblématique de ce quadrant. Exaspérés par les amendes pour retard infligées par les loueurs de vidéo, ses fondateurs, Marc Randolph et Reed Hastings, ont imaginé une solution qui exploiterait la technologie alors balbutiante des DVD. Après avoir testé leur idée en envoyant un DVD par courrier, ils ont créé, à la fin des années 1990, un service permettant aux cinéphiles (de préférence au grand public intéressé surtout par les dernières superproductions) de recevoir et de renvoyer leurs films de cette façon. La stratégie de Netflix était d’exploiter la « longue traîne » des contenus (low cost) et de développer un moteur de recommandations qui renforcerait les relations clients, favorisant ainsi le développement d’une nouvelle méthode de location de films qui périmerait le modèle en dur de Blockbuster (Blockbuster a d’abord snobé Netflix, lui reprochant de négliger le grand public, puis la chaîne a vu les marges de ses magasins s’effondrer avant de disparaître).
Rent the Runway utilise la stratégie de disruption pour transformer le marché vestimentaire féminin haut de gamme. Deux titulaires d’un MBA de Harvard, Jennifer Hyman et Jennifer Fleiss, ont fondé l’entreprise en 2009 après avoir repéré le problème des fashionistas qui achetaient des robes qu’elles ne mettraient qu’une seule fois. Rent the Runway a développé un site Web offrant aux femmes ambitieuses la possibilité de louer plutôt que d’acheter des marques de designers et s’est attachée à résoudre les défis opérationnels et logistiques posés par les envois et retours de vêtements. Bien que la société n’ait pas encore délogé Neiman Marcus (une chaîne de grands magasins de luxe) et d’autres acteurs plus traditionnels qui s’adressent aux clientes fortunées de la haute couture en quête d’une expérience personnalisée en magasin, elle a créé une base de clientèle fidèle qui s’est fait la porte-parole de la marque sur les réseaux sociaux. Sa croissance extraordinaire témoigne de la puissance de l’exécution face à des acteurs traditionnels moins agiles.
LA STRATÉGIE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
La disruption est enthousiasmante ; à côté, une stratégie de chaîne de valeur peut sembler banale. La start-up investit dans la commercialisation et le renforcement de la compétitivité au jour le jour plutôt
que dans le contrôle du nouveau produit et l’établissement de barrières d’entrée, mais son objectif est de s’insérer dans une chaîne de valeur existante plutôt que de viser son renversement.
Une approche banale peut néanmoins donner naissance à une affaire très lucrative. Prenons Foxconn, fabricant chinois d’électronique, l’une des rares entreprises mondiales capables d’industrialiser et de livrer dans les délais les nouveaux produits d’Apple et d’autres groupes. L’identité de ces sociétés se forge davantage dans les compétences que dans la concurrence agressive. Et quoique les entrepreneurs en chaîne de valeur soient guidés par les clients et la technologie d’autres entreprises, ils s’appliquent à développer des talents rares et des capacités sur mesure pour devenir des partenaires privilégiés.
La stratégie de chaîne de valeur est accessible à la plupart des start-up. Tandis que le supermarché en ligne Webvan, fondé en 1996, tentait de disrupter le secteur de la distribution, Peapod devenait l’épicerie Internet américaine numéro 1 en apportant un complément à valeur ajoutée aux distributeurs traditionnels (Webvan a fait faillite en 2001).
Un partenariat précoce avec le distributeur agroalimentaire Jewel-Osco, près de Chicago, a permis à Peapod de repérer ses clientes idéales (des femmes actives) et ce qu’elles appréciaient le plus (la possibilité, entre autres, de passer régulièrement commande et de fixer l’heure de livraison). Tandis que la stratégie de disruption de Webvan supposait de revoir de fond en comble l’expérience des courses, l’approche plus pointue de Peapod lui permettait de développer une offre de valeur précieuse pour des clientes prêtes à payer plus cher des commandes et des livraisons automatisées, prestation qui a débouché sur un partenariat profitable avec la chaîne de supermarchés Stop & Shop. Peapod a accumulé le savoir-faire et développé les compétences spécifiques grâce auxquelles il est en tête du secteur de l’épicerie en ligne depuis près de vingt ans.
Les entrepreneurs qui adoptent l’approche de Peapod créent et s’approprient de la valeur en visant une seule tranche « horizontale » de la chaîne de valeur sur laquelle leur expertise et leurs compétences sont inégalables. Dans aucune autre stratégie entrepreneuriale le rôle de l’équipe fondatrice ne semble plus important. En plus de l’embauche de commerciaux orientés client final ou d’ingénieurs capables d’améliorer techniquement le produit, elle doit pouvoir intégrer des innovateurs, des responsables du développement et des partenaires de la supply chain.
Les capacités de la start-up devront se traduire par une meilleure différenciation ou par un avantage coût pour les entreprises en place. Et même si l’innovation améliore en effet la position concurrentielle de l’ensemble de la chaîne de valeur, la nouvelle société ne s’imposera que si d’autres acteurs de la chaîne sont incapables de reproduire la valeur qu’elle aura créée.
LA STRATÉGIE ARCHITECTURALE
Tandis que la stratégie de la chaîne valeur est le domaine des réussites discrètes, les entrepreneurs qui font le choix, avec succès, de la stratégie architecturale, tendent à être très médiatisés. Cette stratégie permet aux start-up d’être à la fois compétitives et maîtresses de la situation, mais elle est inapplicable pour de nombreuses idées, voire pour la plupart, et extrêmement risquée lorsqu’elle est exécutable. C’est le terrain de jeu de Facebook et de Google.
Les entrepreneurs qui s’engagent dans une stratégie architecturale conçoivent une chaîne de valeur absolument inédite, puis en contrôlent tous les points clés. Ils ne sont pas forcément les inventeurs des technologies sous-jacentes (il y avait des moteurs de recherche avant Google et des réseaux sociaux avant Facebook), mais ils les rendent accessibles au grand public en prenant soin de mettre en cohérence les choix de clientèle, de technologie et d’identité. Face- book s’est engagée très tôt à ne pas facturer ses utilisateurs alors même que la dynamique du média social les enchaînerait à la plateforme. Google a pris pour devise « Ne soyez pas malveillants » afin de s’imposer sans subir les résistances qui ont affecté d’autres entreprises informatiques, à l’instar d’IBM ou de Microsoft. Mais, dans chaque cas, on a supprimé des possibilités de retournement. Autrement dit, les risques pour les entrepreneurs architecturaux proviennent du fait qu’ils n’ont qu’une seule cartouche à tirer pour toucher le gros lot (rappelez-vous la triste histoire de Segway.)
Il n’est donc pas surprenant que les entrepreneurs architecturaux finissent souvent par bâtir des plate- formes plutôt que des produits. Bien que les platesformes puissent être commercialisées avec les autres stratégies, si leur centre névralgique est inaccessible, l’entrepreneur est susceptible de contrôler une nouvelle chaîne de valeur.
Prenons l’exemple d’OpenTable, un service de réservation de restaurants en ligne fondé en 1998 par
Chuck Templeton. Motivé par le défi de simplifier les réservations par téléphone, ce dernier a fait l’hypothèse qu’en plus d’offrir une plateforme de réservation, un intermédiaire en ligne efficace aurait à résoudre le problème de gestion des couverts. Il a donc décidé de développer un système qui combinerait réservations et logiciel de gestion de plan de salle, ce qui le mettait en concurrence directe avec les fournisseurs traditionnels des points de vente comme IBM et NCR.
Comme le rappelle Chuck Templeton, OpenTable ressemblait à ses débuts « à ce fil électrique unique qui court entre les poutres pour fournir lumière et connexion ». Pour amener le marché à sa start-up, il cibla d’abord les restaurants les plus en vue. « Nous avons réussi à avoir les vingt principaux restaurants de San Francisco, explique-t-il, et les cinquante autres ont voulu en être, eux aussi. On a commencé à atteindre la masse critique pour le site. » Chuck Templeton a réorganisé la chaîne de valeur du secteur de la restauration de sorte que l’exploitation des établissements soit intégrée au premier contact que les clients avaient avec eux, c’est-à-dire dès la phase de réservation. Open- Table a pris le contrôle de précieuses données propriétaires sur les préférences et exigences des clients et a établi une plateforme difficile à détrôner, faisant partie de la « panoplie » de tout nouveau restaurateur. Cette domination explique les 2,6 milliards de dollars déboursés par Priceline pour l’acquérir en 2014.
Voyons à présent comment les entrepreneurs peuvent utiliser la boussole stratégique pour choisir parmi les quatre approches de base.
FAIRE SON CHOIX
La première étape consiste à compléter autant de quadrants que possible par des options stratégiques. La tâche n’est pas aisée. Cela suppose de réunir des informations supplémentaires et d’expérimenter jusqu’à un certain point (mais les engagements doivent rester modestes jusqu’à ce qu’un choix soit fait).
On trouvera des approches particulièrement efficaces pour les start-up dans « The Lean Startup », d’Eric Ries, « Business Model Generation », d’Alexander Os- terwalder et Yves Pigneur, et « Disciplined Entrepre- neurship », de Bill Aulet. Toutefois, quelle que soit la méthode choisie, celle-ci doit inclure un processus explicite de construction d’hypothèses et de test, comme l’ont élégamment souligné A.G. Lafley, Roger L. Martin, Jan W. Rivkin et Nicolaj Siggelkow dans « Bringing Science to the Art of Strategy » (HBR édition américaine, septembre 2012).
Ce processus apporte un minimum d’éclairages essentiels sur les contraintes clés associées à chaque direction indiquée par la boussole. Certains choix peuvent être écartés, faute de faisabilité ou de cohérence avec les compétences de l’équipe fondatrice. Dans d’autres cas, les exigences (en termes de capitaux, d’engagement et de vitesse) seront assez claires pour permettre à la start-up de se concentrer dessus afin de faire réussir la stratégie choisie.
Une fois les alternatives identifiées, comment l’entrepreneur doit-il procéder pour choisir ? Revenons à RapidSOS. Discutant des prochaines étapes de leur idée (l’accès aux systèmes d’intervention d’urgence par téléphone mobile), ils utilisèrent la boussole pour identifier quatre stratégies. Comme nous l’avons dit plus haut, ils avaient le choix entre une stratégie architecturale visant à remplacer les systèmes en place par un « Uber des ambulances » ; une stratégie de propriété intellectuelle afin de collaborer avec les acteurs des systèmes d’urgence déjà en place ; une stratégie de chaîne de valeur pour travailler avec les compagnies d’assurances et d’autres partenaires en lien direct avec les consommateurs, devenant ainsi une fonctionnalité d’une application d’entreprise ; ou encore une stratégie de disruption afin de se spécialiser sur un segment de clientèle étroit pour qui l’intervention d’urgence est une priorité (les épileptiques, par exemple) et de s’associer à des associations de malades pour répondre à leurs besoins.
Pour chaque quadrant de la boussole, l’entreprise identifia la clientèle à cibler, la technologie à privilégier, l’identité à revêtir et les concurrents à affronter, ainsi que la manière de le faire. Les quatre voies apparaissaient plausibles, ce qui validait solidement l’idée des fondateurs. S’il n’existe qu’une seule vision viable de l’avenir, c’est que le projet manque sans doute de substance économique.
Disposer de plusieurs options solides n’est pas nécessairement paralysant. L’entrepreneur aura simplement à choisir la stratégie la plus cohérente avec son objectif initial. La mission de RapidSOS d’améliorer le service à l’intention de groupes de malades précis conduisit l’équipe à privilégier avec beaucoup de conviction une stratégie de disruption. Cet engagement que Michael Martin et Nick Horelik étaient en mesure de transmettre avec passion et détermination les aida à convaincre les malades et les partenaires du secteur des urgences, permettant à RapidSOS d’étendre en deux ans sa technologie à l’ensemble du marché.
L’équipe fondatrice ne se contente pas de faire un choix, elle doit l’assumer. La cohérence entre la stratégie et la mission est essentielle pour motiver les créateurs et convaincre les premiers partenaires de s’engager sur cette voie. Soyons clairs : faire un choix exige de s’y impliquer, mais ne ferme pas les autres voies. La décision de RapidSOS de s’adresser à la fois aux associations de malades et aux acteurs des interventions d’urgence a réduit la probabilité qu’elle court-circuite les systèmes d’appel traditionnels, à moyen terme du moins. Mais s’adresser aux associations de malades a favorisé l’engagement des utilisateurs finaux, ce qui, avec le temps, a engendré des collaborations fructueuses et attiré des investissements de la part d’acteurs mieux installés, comme Motorola.
Cela dit, chaque stratégie affecte les éventuels changements de cap (ou pivots) ; chacune en supprime certains et en ajoute d’autres. L’entreprise doit en être consciente afin d’éviter de futurs surcoûts, tout en ménageant des occasions de passer du stade de la start-up à celui du changement d’échelle.
LA BOUSSOLE DE LA STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE n’élimine ni ne réduit l’incertitude inhérente au lancement d’une start-up. En revanche, elle fournit un cadre cohérent pour échapper aux perceptions du paysage existant et identifier d’autres environnements possibles parmi lesquels choisir. Le verbe « choisir » est essentiel ici. Lorsqu’une start-up affronte la concurrence avec de nouveaux produits qui n’apportent pas d’innovation conséquente, son succès est largement déterminé par la manière dont l’environnement affecte ses choix stratégiques. Chez les opérateurs historiques, le gagnant est en général celui qui comprend le mieux l’environnement. Mais les entrepreneurs qui apportent une véritable nouveauté ont l’occasion de remodeler le paysage, voire, comme l’a fait Dolby, d’en dessiner une partie qu’ils détiendront ou, comme Amazon, de créer une réalité entièrement nouvelle. Le choix leur appartient en grande partie. Notre matrice est conçue pour les aider à faire le bon et à mettre leur imagination et leur implication au service de la concrétisation de leur idée.
 |
| Stratégie start-up |
 |
| Stratégie start-up |
04/12/2018
Une brèche dans la suprématie juridique américaine
L’arrêt rendu en août par une cour américaine a ôté aux Etats-Unis une compétence universelle en matière de corruption internationale, expliquent les avocats Félix de Belloy et Ralph Moughanie
Le retrait des Etats-Unis de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien a une fois encore souligné la vigueur de la portée extraterritoriale des décisions américaines. Le monde s’est légitimement ému de cet impérialisme juridique consistant à imposer au monde des règles internes aux Etats-Unis, sans lien de rattachement avec son territoire et en violation des traités internationaux.
Cet état de fait, contre lequel ni l’Europe ni les entreprises ne parviennent à lutter, n’est pas dû qu’à la puissance économique des Etats-Unis ou à la domination du dollar. Il trouve aussi sa source dans l’efficacité des poursuites judiciaires dictées par le procureur américain (le Department of Justice, ou « DoJ »), qui impose ses lois sans que les juges fédéraux aient leur mot à dire.
L’idée, saugrenue en droit, que les Etats-Unis seraient compétents pour juger des faits commis à l’autre bout de la planète au seul motif qu’un courriel aurait transité par Houston ou qu’un virement entre deux étrangers aurait été fait en dollars est celle du DoJ, pas celle de la loi américaine.
Si le DoJ peut faire ainsi sa loi, c’est que les entreprises ciblées par ces affaires ne veulent surtout pas d’un procès dont l’issue est très incertaine, surtout s’il est confié à un jury populaire, et qui peut entraîner la perte de la licence d’exercer aux Etats-Unis, ce qui n’est une option pour aucune entreprise mondialisée. Le DoJ le sait: les banques comme les industriels du monde entier négocieront et accepteront de renflouer les caisses de l’Etat américain.
Faute de procès devant un juge, les jurisprudences relatives à l’application des lois pénales à portée extraterritoriale, notamment en matière de corruption, sont quasi inexistantes, et le DoJ règne ainsi sur la moralité des relations économiques mondialisées. Mais tout n’est pas perdu, car il existe des individus prêts à prendre des risques que les entreprises ne veulent pas courir. C’est le cas d’un dénommé Lawrence Hoskins, citoyen britannique, ancien salarié du français Alstom, pris dans la tourmente de l’affaire où le groupe tricolore, poursuivi par le DoJ pour des faits de corruption en Indonésie, a versé 772 millions de dollars (676millions d’euros) en 2014 afin de clore le dossier.
Hélas, ce «deal» passé par l’entreprise ne mettait pas hors de cause les personnes physiques également impliquées dans le dossier. M. Hoskins, ancien dirigeant d’une filiale de droit anglais d’Alstom, restait donc poursuivi pour « corruption d’agent public à l’étranger » (FCPA) et encourait, à en croire le DoJ, plusieurs années de prison.
PLUS RIEN À PERDRE
Mais M.Hoskins n’a pas eu peur, ou a considéré n’avoir plus rien à perdre. Refusant tout « plaider-coupable », il a saisi le juge fédéral américain de la question qui fâche : celle de sa propre compétence. Selon le DoJ, la justice américaine était territorialement compétente puisque M. Hoskins, bien que n’ayant pas été physiquement présent sur le sol américain, avait autorisé des paiements sur le compte bancaire américain d’un intermédiaire, de même qu’il avait appelé et envoyé des courriels à des collègues américains dans le cadre du prétendu pacte de corruption.
De son côté, l’avocat de M. Hoskins a repris à la lettre les critères de compétence du juge américain tels que la loi FCPA les a fixés: dès lors que son client, de nationalité étrangère, n’avait pas mis les pieds aux Etats-Unis dans cette affaire, la justice américaine ne pouvait le juger sauf à prouver qu’il avait agi en tant que mandataire, employé ou agent d’un « domestic concern », c’est-à-dire, en substance, d’une société américaine ou de la filiale américaine d’une société étrangère.
Par un arrêt du 24 août 2018 confirmant en grande partie le jugement déjà obtenu en première instance, la Cour d’appel fédérale new-yorkaise a fait droit à la position de M. Hoskins, relevant notamment que ce dernier n’avait travaillé que pour la filiale britannique d’un groupe français, et que le procureur n’a pas prouvé, en l’état, qu’il avait agi comme mandataire d’un « domestic concern». La question est donc renvoyée à un nouveau juge.
Adieu courriel, dollar, coup de fil: le juge américain a rappelé au DoJ les termes de la loi, ainsi que le principe d’une « présomption contre l’extraterritorialité », consacré en 2010 par la Cour suprême, selon lequel une loi fédérale n’a pas de portée extraterritoriale, sauf si le législateur l’a explicitement précisé.
LE PROCUREUR AMÉRICAIN AFFAIBLI
Certes, pour les entreprises non américaines, cet arrêt ne va pas radicalement changer la donne. D’abord parce que les risques inhérents à tout procès américain demeurent ; ensuite parce que le DoJ justifiera plus aisément sa compétence contre elles qu’à l’encontre d’une personne physique, dès lors qu’elles sont dotées d’une filiale aux Etats- Unis (le fameux « domestic concern »). Mais la décision Hoskins affaiblit le DoJ dont on sait dorénavant qu’il n’est pas détenteur de la vérité judiciaire lorsqu’il se réclame d’une compétence extraterritoriale.
A l’inverse, elle donne les coudées plus franches aux citoyens non américains poursuivis par le DoJ. Ce dernier, présentant leur condamnation comme inéluctable, fait habituellement pression sur eux pour qu’ils témoignent contre leur entreprise, ou les uns contre les autres, et inversement, chacun gagnant des points de coopération en échange de la délation. Bonne nouvelle : on peut désormais s’en sortir en contestant la compétence du DoJ plutôt qu’en dénonçant son voisin.
Enfin, s’agissant de faits imputables à une entreprise hexagonale, l’arrêt Hoskins est de nature à renforcer la position de nos autorités judiciaires dans le cas, de plus en plus fréquent, d’une procédure ouverte à la fois en France et aux Etats-Unis. Elles pourront s’appuyer sur cette décision pour se prévaloir d’une compétence juridictionnelle plus étroite et légitime que celle des Etats-Unis, et ainsi tempérer les velléités procédurales et l’appétit pécuniaire du parquet américain.
30/11/2018
Les cabinets d’avocats capturent l’octroi de brevets
Des agences de régulation exercent un pouvoir économique important
Leurs décisions créent des bénéfices et des coûts pour un grand nombre d’entreprises et de consommateurs. Depuis longtemps, les chercheurs s’interrogent sur les risques d’un détournement de la régulation (« regulatory capture », en anglais) lorsque des firmes recrutent des employés des agences qui avaient pris des décisions les concernant. Ces employés auraient-ils tendance à favoriser les firmes susceptibles de les embaucher plus tard ?Il a toujours été difficile de savoir si ces risques étaient réels. Un document de recherche du National Bureau of Economic Research américain permet de les estimer (« From Revolving Doors to Regulatory Capture ? Evidence from Patent Examiners », Haris Tabakovic et Thomas G. Wollmann, NBER Working Paper n° 24638, mai 2018).
Les auteurs ont examiné plus de un million de décisions prises entre 2001 et 2015 par plus de 8 000 examinateurs de brevets à l’Office américain des brevets et des marques (US Patent and Trademark Office – USPTO). En moyenne, 63 % des demandes de brevet sont acceptées. Ils ont aussi observé les embauches de ces examinateurs par les demandeurs de brevet (principalement des cabinets d’avocats) après une période de travail à l’USPTO.
Les auteurs constatent que les demandes de brevet sont plus souvent acceptées (avec un écart de 9 à 12points) par des examinateurs qui ont été plus tard embauchés par les firmes demandeuses. Mais, l’allocation des demandes aux employés de l’USPTO étant aléatoire, il ne peut a priori s’agir de l’effet d’un choix de l’examinateur par le demandeur. En revanche, ce différentiel pourrait être le résultat d’un choix des demandeurs de recruter des examinateurs qui leur avaient rendu auparavant, en tout bien tout honneur, le service de prendre des décisions positives à leur égard.
Pour déterminer la direction de la causalité, les auteurs ont regardé si les décisions étaient également plus positives en faveur de demandeurs chez lesquels l’examinateur aurait souhaité travailler. Pour détecter cette catégorie, les auteurs s’appuient sur l’idée que les gens marquent souvent une préférence pour un lieu de travail : si un examinateur en vient à travailler pour un cabinet d’avocats à San Francisco, on peut deviner qu’il aurait été intéressé par d’autres cabinets à San Francisco plutôt qu’à New York.
Des coûts significatifs
En l’occurrence, les demandeurs localisés à proximité de ceux qui finissent par embaucher l’examinateur en question ont aussi des chances élevées de voir leur demande acceptée. Il en est de même pour les demandeurs localisés dans la ville où l’examinateur a fait ses études, ce qui pourrait indiquer également une préférence pour y vivre plus tard. En revanche, ce deuxième constat n’est pas observé pour les examinateurs qui ne sont pas embauchés par la suite par des demandeurs. L’hypothèse d’un biais de la part des examinateurs en faveur de demandeurs localisés dans leur ville de prédilection apparaît donc vraisemblable. Ces biais auraient-ils une incidence sur l’efficacité du système d’octroi de brevets ? Les citations ultérieures des brevets octroyés dans des revues scientifiques sont un indice utile de leur qualité, car un brevet de haute qualité sera souvent utilisé et donc souvent cité. Or, les brevets accordés à des demandeurs qui finissent par embaucher l’examinateur reçoivent entre 21% et 27% de moins de citations en moyenne.
Les biais de détournement de la régulation semblent donc avoir des coûts significatifs, en tout cas pour le système de brevets. Cela ne signifie pas forcément qu’il faudrait interdire l’embauche d’examinateurs par des demandeurs, car cela pourrait décourager des personnes de talent de travailler à l’Office des brevets. Mais maintenant que l’on dispose d’une mesure empirique relativement fiable de la nature des biais entraînés par un tel système, on peut commencer à mieux réfléchir sur la façon de les réduire, si possible...
29/11/2018
La formation des espions du GRU
Des négligences opérationnelles ont sorti de l’anonymat plus de 300 agents du renseignement militaire
 |
| les espions du GRU |
Rien ne transparaît derrière la façade anonyme de l’unité militaire 45-807, le siège moscovite de la direction du renseignement militaire russe, plus connue sous son vieil acronyme soviétique, le GRU. Mais à l’intérieur, l’heure est plutôt au bran-le-bas de combat depuis que les noms de plusieurs dizaines de ses agents clandestins ont été révélés, et leurs visages parfois exposés sur la place publique.
En l’espace de quelques semaines, 305 agents sont ainsi sortis malgré eux de l’anonymat, auxquels il faut ajouter douze agents inculpés aux Etats-Unis, quatre autres expulsés des Pays-Bas, et deux, enfin, recherchés par le Royaume-Uni. Du jamais-vu.
« Seulement 305 agents ont été révélés, mais aujourd’hui plus d’un millier sont paralysés », précise Roman Dobrokhotov, rédacteur en chef du site d’investigation russe The Insider. Ce dernier, en association avec Bellingcat, un site britannique, est à l’origine d’une bonne partie des fuites.
Leur travail en commun a notamment abouti, mi-octobre, à la divulgation, photos et témoignages à l’appui, de l’identité des deux agents du GRU, Anatoli Tchepiga, alias « Rouslan Bachirov », et Alexandre Michkine, alias « Alexandre Petrov », suspectés d’avoir tenté d’empoisonner un ancien de la maison devenu un agent double, Sergueï Skripal, et sa fille, Youlia, en mars, à Salisbury, en Angleterre. Cette affaire a déjà conduit à la plus vaste expulsion coordonnée de diplomates russes d’Occident.
Depuis, les informations ont continué à affluer. Mi-octobre toujours, les Pays-Bas révélaient avoir expulsé Alexeï Morenets, Evgueni Serebriakov, Oleg Sot- nikov, et Alexeï Minine, quatre agents du GRU pris en flagrant délit sept mois plus tôt en train de pirater le réseau informatique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques à La Haye.
Des indices laissés négligemment ont permis de les identifier. Non seulement, les téléphones portables de ces espions étaient enregistrés à Moscou, mais il a suffi d’une note de taxi trouvée sur l’un d’eux pour remonter... jusqu’à l’unité militaire 26-165, c’est-à-dire l’une des principales antennes moscovites du GRU. Sur cette base, en fouillant dans les sources ouvertes sur Internet ou dans des données accessibles au marché noir, des journalistes sont parvenus à infiltrer l’un des piliers du renseignement russe.
Révélations à répétition
A partir d’un nom, celui d’Alexeï Morenets, trouvé dans les fichiers de la police routière, il leur a été aisé de croiser tous ceux qui, comme lui, avaient leur véhicule immatriculé à la même adresse, celle du GRU. De fil en aiguille, les passeports se sont révélés quasi identiques puisqu’ils possédaient un même numéro de série. Les adresses personnelles renvoyaient aux mêmes immeubles d’habitation... Des dizaines d’agents se sont ainsi retrouvés à découvert.
Toutes les données personnelles ont été masquées lors de leur parution, mais le mal est profond. Chasseurs, les agents du GRU sont eux-mêmes devenus traqués. Leurs biographies, leurs états de service et jusqu’aux opérations auxquelles ils ont participé s’étalent désormais en place publique. « C’est d’une simplicité déconcertante, assure Roman Dobrokhotov en prenant pour exemple l’un de ses premiers dossiers d’enquête, lorsque les autorités du Monténégro avaient dénoncé en 2016 – un an avant leur entrée dans l’OTAN – une tentative de coup d’Etat impliquant des Serbes et des agents du GRU. L’un d’eux, Eduard Chirokov, avait financé les Serbes en utilisant Western Union avec comme adresse émettrice celle... du GRU. Et comme il avait déjà été expulsé de Pologne en 2014 [où il aurait travaillé comme attaché militaire adjoint sous le nom d’Eduard Sismakov], il était assez facilement traçable... » La Russie a toujours démenti ces accusations en les qualifiant de « calomnies ».
Ces révélations à répétition nourrissent les soupçons à Moscou. A plusieurs reprises, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, a ainsi accusé The Insider d’être l’instrument de services étrangers. « C’est faux bien sûr, mais c’est assez amusant, car cela crédibilise plutôt nos informations, ironise son rédacteur en chef, Roman Dobrokhotov. Avant, elle disait que c’était des “fake news.” » Fondé en 2013, The Insider emploie treize journalistes. Et ils ne sont pas les seuls à chercher les failles.
Récemment, le journaliste Sergueï Kanev, qui enquête pour Dossier Center, un autre site, créé par l’opposant en exil à Londres Mikhaïl Khodorkovski, révélait que le groupe des « quatre » de La Haye était piloté par Alexeï Minine, diplômé de la première « fac » du GRU, le service de renseignement stratégique où sont formés les « costards », c’est-à-dire ceux envoyés sous couverture diplomatique à l’étranger ou comme représentants de grandes entreprises russes. Or, selon lui, Viktor Iliouchine, attaché militaire adjoint en France invité à quitter le territoire en 2014 après avoir tenté d’obtenir des informations sur l’entourage intime de François Hollande, sortait tout droit des mêmes bancs.
Autre lien mis au jour par le journaliste du site Meduza, basé à Riga (Lettonie), Daniel Tourovski : l’unité militaire 26-165, située à Moscou – la même que celle d’où Alexeï Minine a pris son taxi avant de s’envoler pour les Pays-Bas – abriterait le centre principal des hackeurs russes. Rien n’indique, précise-t-il, que le GRU serait lié aux « usines à trolls » de l’homme d’affaires proche du Kremlin Evgueni Prigojine, montrées du doigt dans l’ingérence russe lors de l’élection américaine en 2016. Mais des « dizaines » de centres de recherches informatiques travailleraient pour l’armée.
Contexte troublé
En mai 2017, quelques jours à peine avant l’élection présidentielle en France, WikiLeaks avait publié les archives des correspondances d’Emmanuel Macron et de son QG. Selon Daniel Tourovski, neuf de ces lettres avaient été modifiées par un employé de plusieurs instituts de recherches associés au GRU.
Dans ce contexte troublé, le président russe, Vladimir Poutine, a célébré le 2 novembre le centenaire du GRU, fondé à Petrograd (redevenue Saint-Pétersbourg) en novembre 1918 par une ordonnance secrète de Léon Trotski (un nom qu’on ne prononce plus en Russie, encore aujourd’hui) et tenté de conforter ses troupes.«En tant que commandant en chef suprême, je connais, sans exagérer, vos capacités uniques, y compris dans le cadre d’opérations spéciales », a-t-il déclaré après avoir rendu un hommage appuyé à l’institution pour son rôle joué depuis 2015 sur le terrain en Syrie.
Mais les critiques ont commencé à pleuvoir dru sur le chef du GRU, Igor Korobov. Nommé par M. Poutine en janvier 2016, ce dernier figure déjà dans les listes des sanctions américaines, après l’attaque des serveurs démocrates durant la campagne présidentielle américaine – ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’assister, avec les deux autres piliers du renseignement russe, Sergueï Narychkine, patron du renseignement extérieur, et Alexandre Bortnikov, chef du FSB (ex-KGB), à une réunion sur l’antiterrorisme en janvier à Washington... D’autres devraient le rejoindre sur les listes noires américaines et européennes.
« C’est une catastrophe, s’insurge Alexandre Goltz, expert militaire. Les dirigeants russes, fascinés par leurs opérations dans le cyberespace, n’avaient pas prévu une telle riposte, mais comme ils s’en sont aperçus, Internet est une arme à double tranchant. Il s’avère que les journalistes sont capables de trouver des informations sur des agents hypersecrets. » Effaré par cette « masse de détails insensés », Valeri Chiriaïev, vice-directeur du journal indépendant Novaïa Gazeta et lui- même ancien officier du KGB, juge « énormes les dégâts causés à l’état- major et à la défense ».
Dans l’affaire Skripal, « la transformation d’un message terrible adressé à tous les traîtres d’Etat en un vaudeville honteux suscite un vif ressentiment », affirme-t-il en déplorant l’absence de couverture : « Ils ne se sont même pas donné la peine de construire une légende ». La version « touristes » avancée par les deux agents du GRU suspectés d’avoir tenté d’empoisonner les Skripal père et fille, et contraints de s’expliquer à la télévision sur ordre du Kremlin, n’a en effet convaincu personne.
« Redéploiement des activités »
« Une erreur tactique a été commise, car, pendant six mois, les Britanniques n’ayant donné aucun indice, le Kremlin a pensé qu’ils n’avaient pas assez de preuves. Poutine a fait une énorme erreur en pensant qu’ils n’avaient que les visages, juge Alexandre Baounov, rédacteur en chef du think tank Carnegie en Russie. Dans les années 1990, une grande quantité de cadres sont partis dans le business, ou dans le crime, et d’autres encore à l’étranger. Les services spéciaux ont dû se réadapter sans être réellement prêts à la guerre hybride. »
« Au travail traditionnel des attachés militaires et d’espionnage industriel se sont ajoutées des missions purement politiques : travail clandestin contre des journalistes et des structures publiques, ingérence dans les processus politiques... », déplore Valeri Chiriaïev. « Le redéploiement des activités tous azimuts du GRU a considérablement augmenté les risques », souligne Alexandre Goltz.
Si Vladimir Poutine avait salué en héros les « petits hommes verts », les Spetsnaz, les forces spéciales du GRU débarquées en 2014 en Crimée sans insignes pour prendre le contrôle de la péninsule ukrainienne, la suite des opérations de ses agents dans le Donbass, quoique démenties par le Kremlin, s’est révélée moins fructueuse. Arrêtés en 2015 dans la région de Louhansk, Alexandre Alexandrov et Evgueni Erofeïev avaient reconnu faire partie des forces spéciales du GRU stationnées à Togliatti, avant d’être échangés en 2016 contre la pilote ukrainienne Nadejda Savtchenko. Le début d’une série noire.
17/11/2018
Des navy Seal assassinent un béret vert au Mali
LA SEAL TEAM 6 ET DES MARINES DES FORCES SPÉCIALES
 |
|
Le sergent Logan J. Melgar, un beret vert assassiné par c'est collègue de l'armée
|
La NAVY a formellement accusé un membre de la SEAL Team 6 d’avoir étranglé un béret vert l’année dernière, puis d’utiliser ses compétences de médecin du terrain pour trancher la gorge de la victime et tenter de truquer les faits afin de couvrir le meurtre.
Les détails de l'assassinat présumé du sergent-chef de l'armée Logan Melgar, du 3ème groupe des forces spéciales, alors qu'il servait dans le Mali en Afrique de l'Ouest, en juin 2017, ont été publier hier par la marine dans le cadre des poursuites contre deux membres de l'équipe SEAL Team 6 et deux forces spéciales Marines.
Les quatre membres de la force anti-terroriste et Melgar participaient ensemble à un groupe de travail antiterroriste basé à l'ambassade américaine à Bamako, capitale du Mali. L'unité a fourni des renseignements et une formation aux forces militaires maliennes dans leur combat contre les insurgés islamiques affiliés à Al-Qaïda.
La mort de Melgar dans les premières heures de la matinée du 4 juin 2017 a provoqué une profonde scission au sein de la communauté des opérations spéciales de l'armée, qui considérait l'assassinat et la tentative de dissimulation présumés comme un signe de l'anarchie de l'équipe d'élite du SEAL Team 6.
Les documents publiés par les militaires décrivent une agression préméditée qui a tourné au meurtre, suivie par une dissimulation qui à durée plusieurs mois par les accusés de l'equipe du SEAL et de la Marines.
Bien que les quatre soldat d'élite aient été inculpés de meurtre, d'homicide involontaire, de complot, d'obstruction à la justice et de cambriolage, les documents montrent que le Navy SEAL, qui aurait étranglé Melgar à mort, serait le plus sinistre du groupe. La marine américaine n'a pas dévoilé les noms des militaires, mais d'autres médias ont déjà identifié l'homme qui aurait étranglé Melgar sous le nom d'Anthony DeDolph (sous-officier) et l'autre SEAL comme étant le premier maître Adam Matthews. DeDolph fait face à la plupart des accusations.
DeDolph, un médecin qualifié, aurait procédé à une trachéotomie sur Melgar - une procédure médicale destinée à ouvrir la gorge et insérer un tube pour permettre le passage de l'air - afin de "dissimuler les preuves des blessures" infligées à la gorge de Melgar. Un médecin légiste a déterminé par la suite que sa gorge était écrasée, selon deux personnes qui ont examiné l'autopsie de Melgar.
Les accusations indiquent que les quatre militaires sont entrés par effraction dans la chambre de Melgar alors qu'il dormait et l'ont "ligoté avec du ruban adhésif." Selon des sources proches de l'enquête, DeDolph a ensuite étranglé Melgar "avec un étranglement", tandis que Matthews et au moins l'un des Marines ont retenu Melgar.
Les documents divulgués par l’armée ne traitent pas du motif de l’attaque, mais des sources proches de l’enquête du service d’enquête criminelle de la marine ont précédemment indiqué que les relations de Melgar avec DeDolph et Matthews étaient exécrable au moment de l’agression nocturne.
Melgar avait indiqué à sa chaîne de commandement que les deux SEAL volaient de l'argent sur un fonds opérationnel utilisé pour payer des informateurs. Une personne informée de l'enquête a également déclaré que DeDolph et Matthews avaient nié leur vol et avait affirmé aux enquêteurs que c'était Melgar qui volait de l'argent et qu'ils l'avaient confronté à ce sujet.
Les enquêteurs ont également découvert que DeDolph et Matthews avaient embauché des prostituées lors de leur mission à Bamako et avaient utilisé leur logement commun à l'ambassade avec Melgar pour des soirées sexe. Melgar s’est plaint que les SEAL aient fait pression sur lui pour ne pas avoir pris part à un comportement qu’il considérait comme illégal et inapproprié.
Les chefs d’accusation retenus contre les quatre personnes n’incluent pas le meurtre avec préméditation, et les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve qu’ils avaient prévu de tuer Melgar. «C’est un passage à tabac qui a mal tourné», a déclaré un officier des opérations spéciales à la retraite, informé de l’enquête.
Les quatre hommes sont entrés par effraction dans la chambre de Melgar à 5 heures du matin, alors que Melgar dormait et ont lancé l'attaque, selon des documents militaires. Les enquêteurs croient qu'après avoir réalisé que Melgar était décédé, la dissimulation a commencé. DeDolph et Matthews ont amené le corps de Melgar, gravement endommagé par la trachéotomie, dans une clinique française de Bamako, où il a été déclaré mort.
Une partie de l'histoire de couverture initiale de la mort de Melgar était que lui et DeDolph s'étaient engagés dans une lutte «mutuellement initiée», comme l'un des Marines l'a décrite aux enquêteurs, devant la porte de Melgar à 5 heures du matin. DeDolph était un professionnel des arts martiaux mixtes c'etait un combattant de la MMA avant de rejoindre la Marine.
Les SEAL et les Marines ont fait une série de déclarations fausses ou trompeuses au cours d'une période de six mois, incluant l'affirmation selon laquelle Melgar était ivre lorsque les SEAL et les Marines sont arrivés dans sa chambre. Un rapport de toxicologie a déterminé par la suite que Melgar n'avait pas d'alcool dans son système au moment de son décès. Selon d'autres personnes familières avec l'enquête du NCIS et des documents militaires, les mensonges ont commencé à s'effondrer.
Selon un ancien chef de l’équipe 6 du SEAL, qui travaille comme consultant pour l’unité de l'armée americaine, les dirigeants du commandement ont discrètement encouragé la marine à engager des poursuites contre DeDolph et Matthews, dans le but de les éloigner du commandement du SEAL pour ne pas nuire à la réputation des forces spéciales.
L’accusation de Melgar selon laquelle DeDolph et Matthews volaient dans les fonds des informateurs a mené à une enquête plus vaste sur des malversations financières potentielles chez SEAL Team 6, impliquant l’utilisation abusive d’argent destiné à des fins opérationnelles et imprévues.
«Nous honorons la mémoire du sergent d’état-major. Melgar, nos pensées restent avec sa famille et ses coéquipiers », a déclaré le capitaine Jason Salata, porte-parole du Commandement des opérations spéciales dans un communiqué. «Si ces allégations d'inconduite sont avérées, elles représentent une violation de la confiance et des normes requises de tous les membres du service. Nous faisons confiance aux membres de notre service pour protéger les intérêts les plus sensibles de notre pays et le faire avec honneur. "
Une accusation de «Article 32», l’équivalent militaire d’une procédure devant un grand jury, est prévu pour le 10 décembre à Norfolk, en Virginie, près du siège de l’équipe 6 du SEAL.
Les quatre accusés sont en service actif et restent libres, la marine ayant déterminé qu'ils ne présentaient aucun risque de fuite.
11/11/2018
09/11/2018
Un citoyen chinois en Belgique extradé vers les Etats-Unis
Xu Yanjun aurait cherché à obtenir des secrets industriels auprès de firmes aéronautiques d'apres le FBI
https://www.wcpo.com/news/local-news/hamilton-county/cincinnati/not-guilty-plea-entered-in-ge-aviation-espionage-caseLa justice américaine a obtenu l’extradition d’un pseudo espion chinois accusé d’avoir tenté de voler des secrets aéronautiques civils à General Electric, qui fournit des moteurs à Boeing et à Airbus. "L’espion", Xu Yanjun, agent du ministère chinois de la sécurité d’Etat, avait été arrêté le 1er avril en Belgique, leurré par le FBI. Les autorités belges ont donné leur feu vert à l’extradition, qui s’est déroulée mardi 9 octobre.
Les extraditions sont rarissimes, parce que les Chinois soupçonnés se réfugient habituellement dans leur pays ou pratiquent le cyberespionnage. Le cas présent relève de l’espionnage classique : selon l’acte d’accusation américain rendu public mercredi 10 octobre, M. Xu a cherché à obtenir des secrets industriels à partir de 2013 auprès de firmes aéronautiques, dont General Electric. L’homme s’est fait passer pour vice-secrétaire général de l’Association pour la science et la technologie du Jiangsu. « Le client ne connaît pas notre identité », se réjouit M. Xu dans un message de décembre 2013, contenu dans l’acte d’accusation.
Pour soutirer de précieuses informations d'apres le FBI, il a invité un salarié de General Electric à faire une simple présentation en Chine en juin 2017 des dernières innovations technologiques de l’entreprise sur les lames et des matériaux de ses aéroturbines, le rémunérant 3500 dollars (3000 euros). Pendant l’hiver 2018, M. Xu demande communication de documents sur ordinateur. Il se montre impressionné et propose un déplacement en Europe, où l’employé lui permettra de copier le disque dur de son ordinateur. La rencontre a lieu le 1er avril, et M. Xu est arrêté.
Faire des exemples d'apres le FBI
Le détail du piège n’a pas été révélé, mais le FBI a fortement communiqué sur cette affaire. Ce cas «fait partie d’une politique de développement de la Chine aux dépens des Etats-Unis. Nous ne pouvons pas tolérer le vol de la puissance de feu de la nation et le fruit de notre savoir-faire. Nous ne tolérerons pas qu’un pays récolte ce qu’il n’a pas semé », a déclaré John Demers, assistant du procureur général pour la sécurité nationale. « Les accusations américaines sont du vent », a répondu jeudi le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang.
La justice américaine cherche à faire des exemples en condamnant des espions. Dans cette période de fort sentiment antichinois, la presse regorge de cas. Cet été, le fabricant d’éoliennes chinois Sinovel a été condamné pour avoir volé au début de la décennie le logiciel de son fournisseur, American Superconductor, et s’est engagé à lui verser 57,5 millions de dollars.
Le dossier de l’espionnage économique était censé avoir été partiellement réglé sous le règne de Barack Obama, lorsque fut révélé en 2013 que l’armée chinoise organisait le cyberespionnage des industriels occidentaux, par le biais d’un groupe de hackeurs. L’année suivante, la justice américaine avait mis en accusation plusieurs militaires chinois – inextradables –, le président Obama avait haussé le ton et avait pu annoncer, en septembre 2015, aux côtés du président Xi, à Washington, que les deux pays cesseraient de se livrer à du cyberespionnage industriel.
L’accord a conduit à une réduction apparente de ces pratiques, mais l’heure n’est pas à la conciliation. Le 4 octobre, le vice-président américain, Michael Pence, s’est livré à une virulente diatribe contre Pékin, l’accusant de harceler la marine de guerre américaine en mer de Chine et d’interférer dans le processus électoral américain. Plus classiquement, il a aussi accusé la Chine d’organiser « le pillage généralisé de la technologie américaine ». Une analyse au fond partagée par les Européens et les Japonais, qui ont condamné, fin septembre, dans un communiqué commun avec les Etats-Unis, « le vol de secrets commerciaux et informations sensibles ».
La guerre commerciale débutée à l’hiver 2018 est un conflit à tiroirs. Le premier grief porté par Donald Trump concernait le déficit commercial bilatéral, qui s’explique par la faible capacité exportatrice des Etats-Unis et n’a pas de solution rapide. Le second conflit concerne les règles de l’Organisation mondiale du commerce, que la Chine ne respecterait pas en subventionnant ses entreprises et en forçant les entreprises américaines à transférer leur technologie aux Chinois pour opérer sur leur territoire. Pékin a fait mine de bouger, mais pas assez aux yeux de l’administration Trump, qui estime que ses prédécesseurs Obama et Bush fils se sont fait mener en bateau. Donald Trump a donc décidé de droits de douane qui frappent une Chine endettée et en ralentissement économique.
Mais ces conflits révèlent au fond un seul reproche, fondamental, contre les ambitions de leadership de Pékin, énoncées dans son plan Made in China 2025, dans les technologies du futur. Ce crime de lèse-puissance envers les Etats-Unis menace de faire tourner la guerre commerciale en guerre froide sino-américaine. L’annonce de l’arrestation de M. Xu intervient quelques heures après que le directeur du FBI, Christopher Wray, a jugé devant une commission du Sénat américain que la Chine constituait « la menace la plus vaste, la plus complexe, la plus durable ». « Par de nombreux aspects, la Russie lutte pour garder son rang depuis la chute de l’Union soviétique. Son combat est dans le présent. La Chine livre la bataille de demain », a commenté le patron du FBI.
08/11/2018
Disruption dans le marché du diamant à Anvers
Le nombre de tailleurs de diamants s’est effondré dans la ville belge, où a été inventé le brillant à 57 facettes. Qu’elle émane d’autres grandes places comme Dubaï et Moscou ou d’Internet, la concurrence est particulièrement féroce
Manuella Merckx fronce les sourcils. La directrice opérationnelle du Diamond Office, le bureau de contrôle des importations et des exportations de diamants, sis à Anvers, aurait dû être avertie de notre arrivée par les vigiles, à l’entrée de l’immeuble du 22 Hoveniersstraat. « Ce n’est pas la procédure », s’agace cette Belge à la poignée de main ferme.
Cet office de contrôle est installé dans les étages de l’Antwerp World Diamond Center (AWDC), l’équivalent de la chambre de commerce et d’industrie des diamantaires d’Anvers, en plein cœur du Diamond Square Mile, quartier sécurisé de la ville portuaire où patrouillent militaires et policiers, 24 heures sur 24. C'est aussi le lieu d'un casse du siècle, qu'est le cambriolage du Diamond Center à Anvers, en Belgique, qui a lieu dans la nuit du 15 au 16 février 2003 dans une banque située en plein cœur du quartier diamantaire d'Anvers. Des voleurs dérobent le contenu de 123 des 160 coffres-forts sans que les systèmes d'alarme ne se déclenchent. Le butin, des diamants, de l'or et des bijoux de grande valeur, est estimé à 100 millions d'euros, ce qui était le record mondial en matière de diamants.
Manuella Merckx fronce les sourcils. La directrice opérationnelle du Diamond Office, le bureau de contrôle des importations et des exportations de diamants, sis à Anvers, aurait dû être avertie de notre arrivée par les vigiles, à l’entrée de l’immeuble du 22 Hoveniersstraat. « Ce n’est pas la procédure », s’agace cette Belge à la poignée de main ferme.
Cet office de contrôle est installé dans les étages de l’Antwerp World Diamond Center (AWDC), l’équivalent de la chambre de commerce et d’industrie des diamantaires d’Anvers, en plein cœur du Diamond Square Mile, quartier sécurisé de la ville portuaire où patrouillent militaires et policiers, 24 heures sur 24. C'est aussi le lieu d'un casse du siècle, qu'est le cambriolage du Diamond Center à Anvers, en Belgique, qui a lieu dans la nuit du 15 au 16 février 2003 dans une banque située en plein cœur du quartier diamantaire d'Anvers. Des voleurs dérobent le contenu de 123 des 160 coffres-forts sans que les systèmes d'alarme ne se déclenchent. Le butin, des diamants, de l'or et des bijoux de grande valeur, est estimé à 100 millions d'euros, ce qui était le record mondial en matière de diamants.
A lui seul, le Diamond Office est censé symboliser la droiture et la transparence que revendiquent les marchands de diamants de la place. Tous les jours, des milliers de pierres brutes et taillées entrent et sortent de cet immeuble moderne. Sous le regard de fonctionnaires et du bureau des douanes, dix-sept experts assermentés par l’Etat belge contrôlent le contenu des paquets sous scellés en provenance ou à destination de l’étranger, en dehors de l’Union européenne.
Le geste est adroit, rapide, presque mécanique. D’un coup de cutter, l’expert tranche les sacs plastiques zippés qui contiennent les sachets de diamants. Puis il verse le contenu de chacun dans le plateau métallique d’une balance électronique pour en vérifier le poids, exprimé en carats (un carat équivaut à 0,2 gramme). D’un œil, il compare le poids annoncé sur la facture à celui qui apparaît sur l’écran de pesée. De l’autre, à l’aide de sa loupe, il contrôle la classification du diamant établie par le bureau de contrôle de l’AWDC. Objectif: vérifier la valeur du lot, qui détermine le montant de la TVA et son prix en dollars. La monnaie américaine demeure la devise officielle du secteur.
« MÉTHODE DE CONTRÔLE TRÈS STRICTE »
En cette matinée d’octobre, quelques secondes auront suffi à cet expert assermenté pour faire tinter les 213 carats de pierres brutes d’origine russe présentées par un diamantaire israélien à destination d’un tailleur anversois. A l’en croire, cette dizaine de gravillons de carbone pur valent bien les 900.000 dollars (790 000 euros) annoncés sur les documents de douane.
Au bureau des exportations, un autre expert vérifie le contenu d’un petit sachet à expédier chez Richemont, numéro deux mondial du luxe. Cette fois, ce sont des milliers de brillants, aussi fins que des grains de sucre cristallisé. Montant : plus de 172 000 dollars. Dans quelques minutes, ils seront placés dans une fourgonnette blindée de la Brink’s pour être livrés aux ateliers de Cartier. D’après l’agente chargée de l’exportation de ce lot, la marque du groupe suisse Richemont les a commandés pour les cadrans de ses montres.
« Chaque jour, plus de 220 millions de dollars transitent dans nos locaux », assure Mme Merckx, tout en vantant cette « méthode de contrôle unique et très stricte», garde-fou belge contre la corruption, le blanchiment d’argent sale et le commerce de diamants en provenance de pays interdits – dont le Liberia – qui, encore bien souvent, entachent la réputation de ce commerce mondial générant 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
La presse est rarement conviée dans ce saint des saints. Mais, si l’AWDC ouvre ses portes, c’est pour mieux défendre Anvers, le berceau du brillant. Il y va de son salut. En effet, le négoce de la pierre brute lui échappe de plus en plus. Les plates-formes électroniques de vente entre professionnels se multi- plient. Et les sociétés minières ont revu leurs méthodes. Les producteurs russes, qui représentent près d’un tiers du marché, vendent à Moscou. C’est le cas notamment d’Alrosa.
Son concurrent, De Beers, premier producteur mondial, a quitté Londres pour organiser les « vues » de ses pierres à Gaborone, capitale du Botswana, l’un des premiers fournisseurs de diamants de la planète. Ce qui « a favorisé Dubaï» comme site de négoce, décode Jean- Marc Lieberherr, président de l’association Diamond Producers Association (DPA), qui défend les intérêts des minières. D’autant que l’émirat attire les tradeurs de diamants en leur accordant une fiscalité avantageuse. Depuis, la place de Dubaï profite de sa situation géographique proche de l’Inde, où sont envoyées « 85 % des pierres brutes pour être taillées en diamants », rappelle M. Lieberherr.
« RÉDUIRE LES FLUX ET LE TEMPS »
Sur le sous-continent indien, les marques les plus réputées se fournissent à moindre coût. L’Inde tire parti de ses 1,2 million de tailleurs, qui travaillent dans les ateliers de Surate (Ouest), à 300 kilomètres au nord de Bombay (Mumbai). Les fabricants de bijoux achètent de quoi monter des «pavages » propres aux bagues modernes bon marché. Dès lors, les compagnies minières ont tendance à vendre directement leurs pierres brutes à Bombay, non loin de ces milliers de petites mains. Il faut faire vite. D’autant que, toujours à proximité, le marché chinois du diamant s’envole. Les consommateurs de l’ex-empire du Milieu raffolent des solitaires, modèle préféré des fiancées américaines qu’ils ont découvert en regardant des séries télévisées.
Toute la filière s’emploie donc à faire fi des intermédiaires. « A réduire les flux et le temps » entre la mine de diamant et le doigt, commente Jean-Marc Lieberherr. La ville d’Anvers n’en ressort pas gagnante. Certes, 80% des pierres brutes transitent encore par la ville médiévale. Mais le secteur ne compte plus que 1 600 diamantaires, contre 1 800 il y a sept ans, selon l’AWDC. Le nombre de tailleurs anversois ne cesse de baisser. Ils ne sont plus que 500. «Dans les années 1970, Anvers en comptait 40 000 », rappelle une porte-parole.
Le secteur espère désormais résister à la déferlante d’Internet, qui impose son nouveau modèle économique. L’américain Blue Nile en a été le pionnier. Ce site vend aux Américains des solitaires bon marché, en ne payant ses pierres aux diamantaires qu’une fois la bague commandée. Résultat : zéro stock. Ce sont les diamantaires qui doivent en supporter le coût, au risque de fragiliser leur trésorerie.
Anvers a des atouts. La ville tire avantage de sa contiguïté avec le bassin de consommation européen. Plusieurs réseaux continuent de se fournir là. Guérin, la filiale de bijouterie du groupe Galeries Lafayette, y achète des lots. « La qualité y est permanente », note Stéphanie Manon, directrice de collection de cette enseigne aux 40 points de vente en France. Gemmyo, site Internet de vente en ligne de bijoux, s’y fournit « par commodité », selon Charif Debs, son président. Et les marques de luxe, filiales des groupes cotés LVMH, Kering ou Richemont, y dénichent les plus belles pièces. « En toute sûreté », car « Anvers, c’est la haute couture du diamant », observe M. Lieberherr.
Un robot pourrait-il sauver Anvers? L’AWDC fonde beaucoup d’espoir sur l’automatisation de la taille. Son centre de recherches a présenté, en mai, une machine automatisée qui taille et polit les diamants bruts de dix à vingt fois plus vite que la main de l’homme ; quatre- vingt-dix minutes suffiraient pour achever les 57 facettes d’un diamant, contre une journée de travail d’ordinaire. «C’est une révolution », estime l’AWDC. Quatre entreprises la testent depuis mai. Ce procédé «pourrait ramener une partie de la taille à Anvers », admet Stéphane Fischler, diamantaire anversois et président du Conseil mondial du diamant. Son nom – Fenix – évoque d’ailleurs celui de l’oiseau légendaire qui renaît de ses cendres.
Le geste est adroit, rapide, presque mécanique. D’un coup de cutter, l’expert tranche les sacs plastiques zippés qui contiennent les sachets de diamants. Puis il verse le contenu de chacun dans le plateau métallique d’une balance électronique pour en vérifier le poids, exprimé en carats (un carat équivaut à 0,2 gramme). D’un œil, il compare le poids annoncé sur la facture à celui qui apparaît sur l’écran de pesée. De l’autre, à l’aide de sa loupe, il contrôle la classification du diamant établie par le bureau de contrôle de l’AWDC. Objectif: vérifier la valeur du lot, qui détermine le montant de la TVA et son prix en dollars. La monnaie américaine demeure la devise officielle du secteur.
« MÉTHODE DE CONTRÔLE TRÈS STRICTE »
En cette matinée d’octobre, quelques secondes auront suffi à cet expert assermenté pour faire tinter les 213 carats de pierres brutes d’origine russe présentées par un diamantaire israélien à destination d’un tailleur anversois. A l’en croire, cette dizaine de gravillons de carbone pur valent bien les 900.000 dollars (790 000 euros) annoncés sur les documents de douane.
Au bureau des exportations, un autre expert vérifie le contenu d’un petit sachet à expédier chez Richemont, numéro deux mondial du luxe. Cette fois, ce sont des milliers de brillants, aussi fins que des grains de sucre cristallisé. Montant : plus de 172 000 dollars. Dans quelques minutes, ils seront placés dans une fourgonnette blindée de la Brink’s pour être livrés aux ateliers de Cartier. D’après l’agente chargée de l’exportation de ce lot, la marque du groupe suisse Richemont les a commandés pour les cadrans de ses montres.
« Chaque jour, plus de 220 millions de dollars transitent dans nos locaux », assure Mme Merckx, tout en vantant cette « méthode de contrôle unique et très stricte», garde-fou belge contre la corruption, le blanchiment d’argent sale et le commerce de diamants en provenance de pays interdits – dont le Liberia – qui, encore bien souvent, entachent la réputation de ce commerce mondial générant 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
La presse est rarement conviée dans ce saint des saints. Mais, si l’AWDC ouvre ses portes, c’est pour mieux défendre Anvers, le berceau du brillant. Il y va de son salut. En effet, le négoce de la pierre brute lui échappe de plus en plus. Les plates-formes électroniques de vente entre professionnels se multi- plient. Et les sociétés minières ont revu leurs méthodes. Les producteurs russes, qui représentent près d’un tiers du marché, vendent à Moscou. C’est le cas notamment d’Alrosa.
Son concurrent, De Beers, premier producteur mondial, a quitté Londres pour organiser les « vues » de ses pierres à Gaborone, capitale du Botswana, l’un des premiers fournisseurs de diamants de la planète. Ce qui « a favorisé Dubaï» comme site de négoce, décode Jean- Marc Lieberherr, président de l’association Diamond Producers Association (DPA), qui défend les intérêts des minières. D’autant que l’émirat attire les tradeurs de diamants en leur accordant une fiscalité avantageuse. Depuis, la place de Dubaï profite de sa situation géographique proche de l’Inde, où sont envoyées « 85 % des pierres brutes pour être taillées en diamants », rappelle M. Lieberherr.
« RÉDUIRE LES FLUX ET LE TEMPS »
Sur le sous-continent indien, les marques les plus réputées se fournissent à moindre coût. L’Inde tire parti de ses 1,2 million de tailleurs, qui travaillent dans les ateliers de Surate (Ouest), à 300 kilomètres au nord de Bombay (Mumbai). Les fabricants de bijoux achètent de quoi monter des «pavages » propres aux bagues modernes bon marché. Dès lors, les compagnies minières ont tendance à vendre directement leurs pierres brutes à Bombay, non loin de ces milliers de petites mains. Il faut faire vite. D’autant que, toujours à proximité, le marché chinois du diamant s’envole. Les consommateurs de l’ex-empire du Milieu raffolent des solitaires, modèle préféré des fiancées américaines qu’ils ont découvert en regardant des séries télévisées.
Toute la filière s’emploie donc à faire fi des intermédiaires. « A réduire les flux et le temps » entre la mine de diamant et le doigt, commente Jean-Marc Lieberherr. La ville d’Anvers n’en ressort pas gagnante. Certes, 80% des pierres brutes transitent encore par la ville médiévale. Mais le secteur ne compte plus que 1 600 diamantaires, contre 1 800 il y a sept ans, selon l’AWDC. Le nombre de tailleurs anversois ne cesse de baisser. Ils ne sont plus que 500. «Dans les années 1970, Anvers en comptait 40 000 », rappelle une porte-parole.
Le secteur espère désormais résister à la déferlante d’Internet, qui impose son nouveau modèle économique. L’américain Blue Nile en a été le pionnier. Ce site vend aux Américains des solitaires bon marché, en ne payant ses pierres aux diamantaires qu’une fois la bague commandée. Résultat : zéro stock. Ce sont les diamantaires qui doivent en supporter le coût, au risque de fragiliser leur trésorerie.
Anvers a des atouts. La ville tire avantage de sa contiguïté avec le bassin de consommation européen. Plusieurs réseaux continuent de se fournir là. Guérin, la filiale de bijouterie du groupe Galeries Lafayette, y achète des lots. « La qualité y est permanente », note Stéphanie Manon, directrice de collection de cette enseigne aux 40 points de vente en France. Gemmyo, site Internet de vente en ligne de bijoux, s’y fournit « par commodité », selon Charif Debs, son président. Et les marques de luxe, filiales des groupes cotés LVMH, Kering ou Richemont, y dénichent les plus belles pièces. « En toute sûreté », car « Anvers, c’est la haute couture du diamant », observe M. Lieberherr.
Un robot pourrait-il sauver Anvers? L’AWDC fonde beaucoup d’espoir sur l’automatisation de la taille. Son centre de recherches a présenté, en mai, une machine automatisée qui taille et polit les diamants bruts de dix à vingt fois plus vite que la main de l’homme ; quatre- vingt-dix minutes suffiraient pour achever les 57 facettes d’un diamant, contre une journée de travail d’ordinaire. «C’est une révolution », estime l’AWDC. Quatre entreprises la testent depuis mai. Ce procédé «pourrait ramener une partie de la taille à Anvers », admet Stéphane Fischler, diamantaire anversois et président du Conseil mondial du diamant. Son nom – Fenix – évoque d’ailleurs celui de l’oiseau légendaire qui renaît de ses cendres.
Baunat ou le pari de la vente en ligne de bijoux en diamant
les fondateurs de baunat patientent. La revente de leur start-up à un grand groupe viendra en son temps. Fondée il y a dix ans à Anvers, en plein cœur du Diamond Square Mile, cette PME em- ployant vingt-cinq personnes, notamment dans la ville belge et à Paris, vend en ligne des solitaires, des bagues et autres bracelets en diamant.
Stefaan Mouradian et Steven Boelens en ont eu l’idée alors qu’ils travaillaient chez Blue Star, gros fournisseur indien de pierres précieuses brutes et taillées. Ensemble, ils créent Baunat en s’inspirant un peu de l’américain Blue Nile, pionnier de la vente en ligne de bijoux racheté en2017 par un consortium de fonds, dont Bain Capital, pour 500 millions de dollars (440 millions d’euros).
L’objectif des entrepreneurs belges ? Vendre sans intermédiaire des bijoux aux millennials, cette génération de consommateurs âgés de moins de 30 ans accros au commerce en ligne, en se fournis- sant à Surate, dans l’ouest de l’Inde. Car, comme on vend un bidon de peinture en fonction de son RAL (couleur), de sa finition et de son poids, « il est possible de vendre un diamant sur Internet», explique M. Mouradian. La standardisation de cette pierre en fonction de son poids exprimé en carats (1 carat = 0,2 gramme), de sa teinte, d’un blanc extrême au jaune teinté, de sa pureté et de sa forme (brillant, marquise, poire, etc.) facilite la vente sur écran.
Baunat propose à ses clients une gamme courte et des petits prix, notamment pour les modèles à présenter lors d’une demande en mariage. La start-up les obtient en signant l’achat de la pierre auprès des diamantaires après sa vente au particulier. Contrairement aux bijoutiers, la société n’a pas à supporter les coûts liés à un éventuel stock de diamants.
les fondateurs de baunat patientent. La revente de leur start-up à un grand groupe viendra en son temps. Fondée il y a dix ans à Anvers, en plein cœur du Diamond Square Mile, cette PME em- ployant vingt-cinq personnes, notamment dans la ville belge et à Paris, vend en ligne des solitaires, des bagues et autres bracelets en diamant.
Stefaan Mouradian et Steven Boelens en ont eu l’idée alors qu’ils travaillaient chez Blue Star, gros fournisseur indien de pierres précieuses brutes et taillées. Ensemble, ils créent Baunat en s’inspirant un peu de l’américain Blue Nile, pionnier de la vente en ligne de bijoux racheté en2017 par un consortium de fonds, dont Bain Capital, pour 500 millions de dollars (440 millions d’euros).
L’objectif des entrepreneurs belges ? Vendre sans intermédiaire des bijoux aux millennials, cette génération de consommateurs âgés de moins de 30 ans accros au commerce en ligne, en se fournis- sant à Surate, dans l’ouest de l’Inde. Car, comme on vend un bidon de peinture en fonction de son RAL (couleur), de sa finition et de son poids, « il est possible de vendre un diamant sur Internet», explique M. Mouradian. La standardisation de cette pierre en fonction de son poids exprimé en carats (1 carat = 0,2 gramme), de sa teinte, d’un blanc extrême au jaune teinté, de sa pureté et de sa forme (brillant, marquise, poire, etc.) facilite la vente sur écran.
Baunat propose à ses clients une gamme courte et des petits prix, notamment pour les modèles à présenter lors d’une demande en mariage. La start-up les obtient en signant l’achat de la pierre auprès des diamantaires après sa vente au particulier. Contrairement aux bijoutiers, la société n’a pas à supporter les coûts liés à un éventuel stock de diamants.
Inscription à :
Commentaires (Atom)